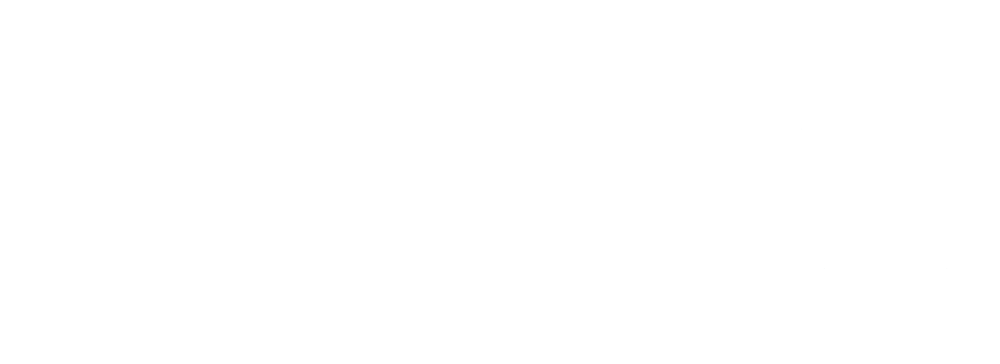Donnée associée à l’article : « Théâtre, mémoire et réparation au Rwanda. Table-ronde : IFRA-Nairobi, le 1er février 2019 ». https://doi.org/10.34847/nkl.607drgym
Retranscription éditorialisée de cette discussion (également disponible à la suite de cet article).
Introduction : la parole « hors-plateau » comme source
Une conversation à cinq voix qui se déroule autour d’une table, ce que l’on appelle communément une « table-ronde », peut-elle être considérée comme une source pour la recherche en sciences humaines ? Quel statut ces paroles improvisées dans l’échange des expériences et des points de vue, puis transcrites et éditorialisées pour les besoins de la cause (disponible ici et en annexe de cet article) ont-elles par rapport au terrain, a fortiori quand cette conversation, cette table-ronde, s’est tenue en dehors du terrain ? Quelle richesse heuristique cette conversation, sur le théâtre au Rwanda qui s’est tenue « hors sol », « hors-plateau » pourrait-on dire pour filer la métaphore théâtrale1, charrie-t-elle, au regard des « matériaux » et autres sources collectés et coproduits sur le terrain ? En quoi les modalités mêmes d’un échange circulaire de paroles permettent-elles une parole peut-être plus articulée, en tout cas plus ciblée, une pensée plus élaborée et moins consensuelle que si elle s’était tenue à l’endroit directement concerné par cette conversation analytique, à savoir au Rwanda ?
Ce sont là les questions qu’a de prime abord soulevées le statut de ce qui est devenu un support écrit, à savoir la retranscription de cette table-ronde « Théâtre, mémoire et réparation au Rwanda » qui s’est tenue à Nairobi en février 2019 et qui a fait l’objet d’un enregistrement par l’institution hôte. Cet enregistrement a ensuite fait l’objet d’une retranscription précise par Antoine Kauffer (journaliste-pigiste et éditeur free-lance spécialisé dans la littérature d’Afrique de l’Est), qui a également fait des propositions d’éditorialisation. Autrement dit, fort de sa bonne connaissance du contexte, il a suggéré quelques coupes et des reformulations et proposé de structurer l’entretien en autant de parties et sous-parties, afin de rendre plus visible la progression de la discussion. La parole n’a pour autant pas été réagencée, la progression des arguments mobilisés dans la discussion ayant été conservée. J’ai ensuite revu l’ensemble pour amender ses interventions puis ai fait lire aux intervenantes pour recueillir leurs amendements respectifs.
Cette rencontre réunissait, dans la salle de conférences de l’IFRA, une artiste rwandaise installée à Kigali (Carole Karemera), une psychologue sociale et politologue rwandaise, familière de la scène artistique rwandaise et également installée à Kigali où elle a fondé le centre Iriba sur la mémoire du génocide et les archives audiovisuelles (Assumpta Mugiraneza), une docteure française en performance studies, auteure d’une thèse sur le théâtre au Rwanda, résidente au Rwanda pendant dix ans (Ariane Zaytzeff), ainsi que les deux chercheuses organisant cette table-ronde (Armelle Gaulier, et moi-même).
Affiche originale de l’événement
« “Theatre, Memory and Reparation in Rwanda (Seminar in French).” Venue: IFRA. DATE: 1st February 2019. Time: 4pm- 6 pm. With Dalila Boitaud, Assumpta Mugiraneza and Ariane Zaytzeff. Facilitators: Maëline Le Lay & Armelle Gaulier. »
IFRA-Nairobi, 2019. Cette affiche avait circulé en janvier 2019 ; Carole Karemera avait finalement complété le panel et Dalila Boitaut-Mazaudier annulé sa venue après l’édition de cette affiche.
Voir version PDF en ligne : https://apela.hypotheses.org/files/2019/01/Roundtable-Theatre-memory-and-reparation.pdf [archive].
Voir aussi l’annonce de l’événement sur le site de l’IFRA : https://web.archive.org/web/20191103005653/http://ifra-nairobi.net/2569.
Après avoir analysé les conditions d’énonciation d’une parole sur le théâtre, je mettrai en lumière les différentes facettes de ma recherche sur le théâtre dans le Rwanda post-génocide qui sont apparues comme des points saillants de cette conversation.
Commençons, en préambule, par poser le cadre et la genèse de cette réflexion sur les potentialités du théâtre dans le Rwanda post-génocide. Elle s’inscrit dans une perspective plus large qu’est celle de ma recherche sur les dynamiques littéraires et théâtrales dans l’Afrique des Grands Lacs, une région qui vit un contexte de post-génocide (Rwanda) et de (post)-conflit (RDC, Burundi), et pour les besoins de laquelle j’ai séjourné une douzaine de mois dans la région entre 2018 et 2021.
Dans le cadre de cette recherche en cours, je cherche plus particulièrement à retracer la généalogie des discours dominants dans les mondes de l’art en matière de pratique artistique dans la région et, plus largement, à comprendre les mécanismes sociaux agissant sur les artistes investis auprès des publics dans un accompagnement des processus de vivre-ensemble, que cela s’inscrive dans des politiques de réparation, réconciliation ou plus simplement de cohésion sociale. Cela implique la nécessité de décrypter la part d’empirie inhérente à chaque entreprise artistique, comme à chaque projet de recherche mené dans la sphère académique. Aussi, ce travail se fait-il volontiers réflexif, à l’instar de cet article dans lequel je m’interroge sur ma « méthode », mon approche des textes et des spectacles, des artistes et du terrain.
Revenons à présent à l’objet de cet article qui en est le point de départ. L’objet à partir duquel je tente de développer une réflexion sur le théâtre au Rwanda – son historique et ses enjeux des années 2000 à la décennie 2020 – au prisme de mon approche propre, c’est cette retranscription d’une conversation à trois voix (ou à cinq, si l’on ajoute les discutantes de la table-ronde) sur le théâtre et les arts de la scène dans le Rwanda post-génocide.
En guise de préalable, commençons par énoncer le fait que les récits et témoignages du génocide et leur mise en scène sont, dans cette conversation, érigés au rang de nécessité quasi-vitale par les intervenantes, et ce pour rompre le silence et ainsi tenter de renouer le lien entre les habitant·e·s divisé·e·s par un passé récent et toujours traumatique.
La nécessité de la prise de parole après l’événement procède essentiellement, au Rwanda, d’une politique gouvernementale de justice restaurative. Le Rwanda a mis en place les désormais célèbres tribunaux gacaca, tribunaux à ciel ouvert inspirés des assemblées de village destinées à régler conflits et contentieux. Organisés sur chaque colline, entre 2001 et 2012, dans l’optique de confronter les victimes, rescapées du génocide, appelées à livrer leur témoignage, et leurs bourreaux, exhortés à avouer leurs forfaits et à demander pardon, ils reposaient entièrement sur la confiance dans le pouvoir libérateur de la parole : celle des rescapés comme celle de leurs bourreaux2. Un des articles de l’historienne Hélène Dumas, qui a consacré aux tribunaux gacaca sa thèse de doctorat, s’ouvre d’ailleurs par l’épigraphe suivante, de José Kagabo, traduisant l’importance de cet enjeu crucial pour la construction du Rwanda post-génocide : « Comment gérer cette mémoire génocidaire avec, premièrement, ces horreurs et, deuxièmement, si ces horreurs-là n’étaient pas dites3 ? » Dans son dernier ouvrage qui prend pour objet les cahiers de récits du génocide écrits par des personnes qui étaient enfants au moment de l’événement, Hélène Dumas observe que la saisie de l’écriture par les survivants fut en outre une « entreprise encouragée assez tôt après le génocide », également par les associations de rescapés telles Ibuka et AVEGA (Association des veuves du génocide d’avril), entreprises qui s’inscrivent dans « une perspective de catharsis psychologique et testimoniale » (Dumas 2020, 12-134).
La question de José Kagabo, interrogeant la cohésion sociale aux lendemains de l’événement dans les traces encore fraîches des massacres, a trouvé un écho sur le plateau de théâtre où les artistes et intellectuelles « retournées »5, comme Carole et Assumpta, trouvèrent leurs pairs, encore blessés et en proie à la sidération, comme elles le racontent dans la table-ronde. Il leur est apparu qu’il fallait avant tout ménager un espace singulier pour pouvoir exprimer cette expérience si singulièrement atroce et traumatisante qu’est le génocide. En effet, elles s’apercevront bien vite qu’écrire et dire contre le silence, après le génocide, implique la réinvention d’une langue et d’un langage propre à la scène.
Dans un second temps, nous verrons comment ces créations théâtrales réalisées au Rwanda ont pu être remises en perspective dans un corpus plus large de spectacles sur le Rwanda, dont ceux, à la portée internationale, commis par des créateurs européens, créés et/ou diffusés au Rwanda. Ce genre de création, dont on pourrait considérer avec Annick Asso qu’elle tombe dans la catégorie du « théâtre du génocide » (Asso 2012), pose, dès lors, d’épineuses questions relevant d’une éthique de la prise de la parole et de la représentation d’un tel événement par une personne extérieure au contexte.
Enfin, cette discussion sur les caractéristiques, les richesses et les risques, les aspérités et les fragilités de toutes ces créations théâtrales et spectaculaires pose in fine la question des enjeux de la représentation. L’urgence et l’importance de la transmission d’une mémoire s’imposent comme impératif premier. Cela est la plus grande balise à faire flotter dans la mer des histoires du Rwanda6, en guise de tentative d’« enterrer les morts [et] réparer les vivants », d’après la belle formule de Tchekhov dans Platonov7. Ce dialogue constitue une très riche conversation sur la création en arts de la scène, entre des personnes actrices du champ artistique et observatrices de ce champ. S’y entrelacent un discours réflexif de type méta-théâtral (tenu par Carole Karemera, femme de théâtre) et un discours plus analytique, informé par une excellente connaissance du Rwanda et par les sciences humaines et sociales (discours tenu par la psychologue sociale Assumpta Mugiraneza). La troisième intervenante, Ariane Zaytzeff, est au croisement des deux autres, étant à la fois du monde du théâtre au Rwanda, et chercheuse.
Les traces – quelque peu remodelées – de cette conversation sont précieuses, car les échanges nourris, posés, de qualité, et dépouillés des filtres bien souvent de mise lorsque les échanges se tiennent au Rwanda, sont plutôt rares, aux dires des participantes, corroborés par mon expérience. Il m’a en effet été difficile, durant mes nombreux terrains au Rwanda, de m’entretenir longuement avec la plupart des gens de théâtre que je sollicitais. La difficulté de rencontrer une parole fluide et apparemment libre au Rwanda a maintes fois été documentée par des chercheurs ayant écrit sur le silence comme expérience singulière dans leurs interactions dans le pays (Smith 2022 ; Thomson 2011 ; 2010 ; Burnet 2012). Avec le recul, je me rends compte que les conversations les plus riches que j’ai pu avoir sur le Rwanda pré et post-génocide, ou sur le génocide en lui-même, étaient en majorité non tant celles que j’avais pu avoir avec les artistes de la scène (qui m’ont semblé moins faciles d’accès) que celles que j’avais avec des Rwandais·es ayant écrit des textes littéraires (des récits), parfois des textes académiques (de type essais).
Or, je suis frappée, à relire cette table-ronde, de la place centrale qu’occupent les récits et témoignages du génocide – préalablement écrits et souvent publiés – dans les spectacles dont il est question. Ils en sont souvent, ou bien le point de départ, le socle fondamental, ou bien alors ils en constituent des éléments clés.
Les récits et témoignages et leur mise en scène pour rompre le silence
Lorsqu’elles évoquent les différentes créations théâtrales dans lesquelles elles ont été impliquées ou dont elles ont été les spectatrices attentives, les intervenantes font référence à de nombreux récits, dont une importante part est d’ordre autobiographique puisqu’il est en effet beaucoup question de témoignages de rescapé·e·s.
Certaines dramaturges font le choix d’intégrer dans leurs spectacles des récits qui ont été composés pour la scène et qu’elles ont commandés. C’est le cas d’Odile Gakire Katese qui, pour son spectacle The Book of Life (dont Ariane Zaytzeff nous entretient dans cette conversation de table-ronde) a demandé à des rescapé·e·s d’écrire des lettres à un proche disparu pendant le génocide ou la guerre qui l’a précédé. Ce projet, entamé en 2009, a été réalisé dans le cadre d’ateliers d’écriture qui accueillaient tant des génocidaires que des veuves et des orphelin·e·s du génocide8.
Son ambition, en inscrivant le texte des lettres au texte théâtral, était de contribuer à créer une « mémoire apaisée »9 du génocide pour la transmettre à la société rwandaise traumatisée. Elle tenait en outre à ce que les morts ne sombrent pas dans l’oubli ; ainsi fallait-il les nommer sur scène et parler d’eux. Il y a chez elle l’idée selon laquelle provoquer le récit par le passage à l’écrit (et le format contraint de la lettre) matérialise la prise de parole, constituant ainsi le matériau premier d’une création en gestation : « When you write, you bring life! You create something! » (Katese 2019.) C’est le récit écrit, élaboré pour les besoins du spectacle, qui en forme l’épine dorsale.
Cet usage du récit est pour le moins fréquent parmi les spectacles discutés par les intervenantes à la table-ronde. La plupart des spectacles sont en effet élaborés à partir de récits qui leur préexistent. Ce sont des récits de fiction ou bien des témoignages qui ont fait l’objet d’une publication préalable, et qui sont alors adaptés au théâtre. Le spectacle dont parle Carole Karemera, Hagati Yacu (« Entre nous » en kinyarwanda, 2014), co-réalisé avec Dalila Boitaud de la Compagnie Uz et Coutumes d’Uzeste en Gironde, est adossé à un roman, Murambi, le livre des ossements du romancier, essayiste et éditeur sénégalais Boubacar Boris Diop (2000). Murambi est sans doute l’un des romans écrits en français les plus connus sur le génocide. Cela est certainement dû à la notoriété de son auteur qui l’a écrit lors d’un voyage au Rwanda en 1998 sous l’impulsion du festival Fest’Africa de Lille, qui organisa à Kigali une résidence d’écriture pour écrivains africains francophones, baptisée « Rwanda : Écrire par devoir de mémoire ». Cette mobilisation des écrivains du continent a joui d’une certaine médiatisation, ce qui permit d’attirer l’attention sur l’un ou l’autre texte conçu lors de cette résidence d’écriture, dont celui de Boubacar Boris Diop10. Par ailleurs, il ne cachera pas, dans ses essais et autres textes pamphlétaires parus dans la presse ultérieurement, le fait que l’expérience du Rwanda lui servit de révélateur violent du potentiel de nuisance de la Françafrique, et même de son caractère létal. Cette résidence d’écriture marque un tournant dans son engagement politique contre l’impérialisme occidental, et notamment contre l’ingérence française en Afrique, et initie une série d’écrits prenant pour cible ce qu’Achille Mbembe qualifie, lui, de nécropolitique. Ce concept que Mbembe définit comme la souveraineté d’un pouvoir qui, sur des critères xénophobes et à partir de dispositifs juridico-politiques tels que l’état d’exception, exerce une violence létale sur un groupe d’individus, s’est particulièrement illustré à travers le colonialisme et ses suites : le néo-impéralisme vilipendé par B. B. Diop (Diop 2005 ; Traoré et Diop 2013 ; voir aussi Mbembe 2006).
Murambi est dès lors un texte aussi connu des amateurs de littérature que du milieu militant luttant pour la reconnaissance du génocide des Tutsi, le roman écharpant de manière cinglante la France pour ses agissements coupables lors de l’événement et en amont de celui-ci. C’est d’ailleurs sur un extrait de ce roman que s’ouvre le récent documentaire de Gaël Faye et Michael Sztanke, Rwanda : Le Silence des mots (2022), portraiturant trois rescapées, femmes violées par des soldats français et laissées pour mortes.
Si Murambi est un texte de fiction, il s’inspire de près de plusieurs récits et témoignages qui ont été donnés à l’auteur lors de son voyage, si bien que ce dernier récuse le terme de roman. Cultivant la même indétermination générique, Jean Hatzfeld, dont il est question dans le spectacle Igishanga (2002) rapidement évoqué par Assumpta Mugiraneza, est connu pour sa « série rwandaise », cet ensemble de textes portant sur le génocide, à la croisée du témoignage et de la création littéraire. Le journaliste ne se contente pas de transcrire tout bonnement les histoires qu’on lui confie depuis cette même colline de Nyamata où il vient poser ses valises régulièrement ; sa spécificit,é c’est qu’il les transmet en réalisant un important travail de cisèlement linguistique qui donne lieu à un style tout à fait singulier, à une voix – timbre et intonations – qui est devenue sa marque de fabrique. Ce sont des extraits de son tout premier opus rwandais, Dans le nu de la vie. Récit des marais rwandais (2000) qui ont été adaptés à la scène par la comédienne et metteuse en scène française Isabelle Lafon.
Certains metteurs en scène vont plutôt avoir à cœur de recueillir une parole directe sur le génocide, une parole de rescapé·e qui ne soit pas médiée par un regard tiers. Et c’est alors que le témoignage personnel, le récit autobiographique est mobilisé et amené sur scène dans toute son âpreté. Tel celui de Yolande Mukagasana, rescapée et auteure de La mort ne veut pas de moi (1997, sans doute l’un des plus célèbres témoignages de rescapé·e·s écrits en français), qui constitua la source première d’inspiration du spectacle Rwanda 94 du Groupov (2000), réuni autour du metteur en scène belge Jacques Delcuvellerie. Ce dernier ne se contenta pas de reprendre une large part de son témoignage écrit, il l’invita à rejoindre l’équipe et lui donna un rôle sur scène : le sien. Le spectacle total que représente Rwanda 94 s’ouvre donc sur le récit autobiographique de Yolande Mukagasana qui, très tôt, éprouva la nécessité de prendre la plume et de raconter son supplice dans ce récit autobiographique. Quelques années plus tard, n’incarnant personne d’autre qu’elle-même sur le plateau, lui sera alors donnée l’occasion d’énoncer sur scène son terrifiant récit qui ouvre, de manière bouleversante, le spectacle Rwanda 9411.
Le tissage, dans le fil de la diégèse théâtrale, de récits et témoignages permet de rendre palpables les horreurs commises, de créer un sentiment de proximité et d’empathie chez le spectateur pour qui devient alors audible le vécu traumatique de celles et ceux qui ont traversé le génocide et y ont survécu. Ces procédés énonciatifs et narratifs visent à combattre le silence et l’oubli, à empêcher l’envahissement du vide et l’anéantissement total provoqué par l’évanouissement de la mémoire des morts qui découlerait de la disparition physique des corps massacrés. À l’instar de l’ambition portée par la résidence d’écriture de 1998 au Rwanda, l’omniprésence, au théâtre, de ces récits (en partie à caractère autobiographique) semble obéir à une conception transitive des arts de la scène applicable à des sociétés traumatisées, à savoir « écrire/créer comme devoir de mémoire ». Cette poétique de type fonctionnaliste repose sur la conviction selon laquelle libérer la parole évitera le traumatisme de l’occultation, du déni de réalité et de l’oubli. Ce parti-pris a gagné la majorité des programmes d’aide internationaux qui ont fait du théâtre un outil dans les pays dits en voie de développement, dans la lignée de la politique de développement culturel lancée à la fin des années 1970 et de manière plus significative dans les années 198012.
C’est aussi l’ambition du récent documentaire Rwanda : Le Silence des mots de Michael Sztanke et Gaël Faye avec ces femmes qui décident de faire le voyage en bus pour se rendre sur le lieu où elles ont enduré d’ignobles sévices sexuels à la fin du génocide et de raconter à leurs filles, ainsi qu’au réalisateur et à l’écrivain qui les accompagnent, le récit de ces horreurs, pour limiter les effets du traumatisme13. Pour autant, on le voit, raconter est difficile. Que ce soit sur les lieux du crime, au milieu de ce qui semble être une terre en friche sur une colline de Nyarushishi et à Murambi14, ou bien dans la chaleur et la sécurité de leurs foyers respectifs, la parole ravive le souvenir qui les mortifie. Elle se délie péniblement dans un flux sobre, un peu haché : tantôt entrecoupée de larmes, tantôt elle s’étrangle dans un rire nerveux. C’est que, commente gravement Gaël Faye à la fin du documentaire, « l’histoire d’un génocide ne finit jamais de s’écrire. Et les témoins qui ont réchappé au désastre se risquent parfois à nous raconter des histoires dont il ne reste que des ruines. Des récits dont les mots sont des silences » (Rwanda : Le Silence des mots 2022).
Cette dernière phrase du célèbre musicien et écrivain franco-rwandais inscrit tragiquement les récits des rescapé·e·s dans la catégorie de l’indicible qui a maintes fois été mobilisée s’agissant des écrits du génocide, fût-ce la Shoah ou le génocide du Rwanda. À propos des poèmes de Paul Celan au cœur des études sur l’indicible15, le philosophe Philippe Lacoue-Labarthe écrit : « Ils se dérobent nécessairement à l’interprétation, ils l’interdisent. Ils sont écrits, à la limite, pour l’interdire » (Lacoue-Labarthe 2015 [1986], 23). S’interrogeant sur ce que produisent de tels textes, il ajoute : « Qu’est-ce qu’une œuvre de poésie qui, s’interdisant de répéter le désastreux, le mortifère déjà-dit, se singularise absolument ? » (Ibid., 25.)
Même si ces femmes qui racontent à l’écran leurs supplices et leur douleur de vivre ne font pas de la poésie, ce qui est mis à mal, empêché ou interdit dans la parole quelle qu’elle soit, c’est la langue et la possibilité de raconter, de construire du sens avec des mots. L’expression « le silence des mots » désigne ainsi le fait que, même proférés, les mots de ces récits ne résonnent pas, ils échouent à traduire l’intensité et l’acuité de ce qu’ils désignent.
La parole ne peut donc, dans ce cas, qu’être singulière ; la langue articulant la parole ne pouvant qu’être forcément et foncièrement autre. De fait, non seulement le silence apparaît comme un leitmotiv constant tant dans le discours des intervenantes16 que dans les textes littéraires portant sur le génocide et dans les témoignages des rescapé·e·s, mais est également exprimée unanimement la nécessité de forger de nouvelles langues et de nouveaux langages.
Comment, d’abord, faire avec ce silence si prégnant au Rwanda, de l’époque du génocide à nos jours ? De quel silence s’agit-il, pour taire quels faits ou quelles pensées, quelles idéologies ? Le silence étant politique, la question mérite d’autant plus d’être posée s’agissant du Rwanda et de l’écheveau compliqué que le génocide déplie depuis sa perpétration, d’un bout à l’autre du spectre, des survivants aux génocidaires et affiliés. Comment, aussi, appréhender ce silence en tant qu’artiste et en tant que chercheur ou chercheuse ? C’est à cette question que tente de répondre Bobby Smith dans son article « Navigating Silence. An Ethnographic Encounter in Rwanda » (Smith 2022). Il y articule son expérience sensorielle du silence au Rwanda où il se rend pour la première fois en 2019 pour la vingt-cinquième commémoration du génocide, à son observation du festival d’arts de la scène Ubumuntu qui se déroule à la fin de la période de commémoration au mémorial de Gisozi à Kigali. Bobby Smith pose l’hypothèse que ce silence – contemporain donc – découle de la peur, c’est-à-dire de la crainte de la censure et de la grande sévérité de l’encadrement étatique des commémorations, comme du fonctionnement quotidien du pays. De nombreux travaux académiques ont en effet pointé le caractère autoritaire du régime de Paul Kagame qui corsète la parole, voire l’interdit, et qui contraint les actes des citoyens, y compris les plus ordinaires17
L’anthropologue Jennie Burnet, dans son ouvrage Genocide Lives in Us : Women, Memory and Silence in Rwanda, consacre une analyse importante au silence qu’elle rencontre régulièrement au cours de ses enquêtes et qu’elle attribue, elle-aussi, à la peur et à la censure. Ce silence « amplifié », comme elle le qualifie, désigne à la fois l’autocensure des individus et l’intervention de l’État à l’endroit de discours qui mettent à mal le gouvernement, tels par exemple les exactions du FPR lors de la libération du pays en juillet 1994 ou dans ses suites au Zaïre de l’époque18 : « Le silence amplifié est à la fois l’état de silence et le fait d’“ensilencer”. Le silence amplifié n’est pas le sous-produit de pratiques de deuil nationalisées. La peur est sa fondation » (« Amplified silence is simultaneously the state of silence and the act of silencing. Amplified silence is not an inconsequential byproduct of nationalized mourning practices. Fear is its foundation19 » ; Burnet 2012, 110-111).
Observant elle aussi la prégnance du silence dans les interactions quotidiennes, Susan Thomson y lit plutôt une attitude de résistance face aux injonctions gouvernementales à la réconciliation. Elle décrit chez ses interlocuteurs une tactique de « mutisme renfermé qui sabote les efforts des officiels locaux de promotion de la réconciliation parmi les paysans rwandais » (« withdrawn muteness […] that sabotages the efforts of local officials to promote reconciliation among Rwandan peasants » ; Thomson 2011, 453) et en conclut que « quand ils n’expriment aucune opinion, apparaissant ainsi comme conciliants, de nombreux observateurs ordinaires en concluent que les gens croient au bien-fondé du régime et le soutiennent. Leurs actes quotidiens de résistance illustrent l’opposé » (« when they express no opinion, and therefore appear compliant, many casual observers conclude that peasant people believe in and support the regime. Their everyday acts of resistance illustrate the opposite » ; ibid., 456).
Les descriptions des interactions des interlocuteurs de Thomson montrent que le silence peut tout autant être une façon de défier l’autorité par une résistance passive non dénuée de mépris qu’une façon de se protéger, en refusant de se mettre en avant. Une attitude qui ne va pas sans risque du reste, tant un silence obstiné à l’endroit où l’on attend, voire où l’on commande une parole d’un registre particulier, celui de la réconciliation, peut au contraire attirer l’attention sur soi et entraîner des avertissements réprobateurs.
Rejoignant Thomson sur la fonction protectrice du silence, Jennie Burnet, quoiqu’elle l’attribue majoritairement à la peur et à un processus de silence actif et délibéré qu’Aurore Vermylen et Julien Moriceau (2021) appellent « ensilencement » au Burundi (dont la similitude avec le Rwanda, à la fois historiquement et culturellement, a maintes fois été soulignée), reconnaît cependant que le silence peut également être pour les individus un mode de protection pratiqué d’autant plus efficacement qu’il s’enracine dans un habitus rwandais : « Une des motivations du silence de Mutara, Diane et Flore aurait pu être la réticence à parler de leurs expériences violentes avec moi pour leur permettre de conserver leur souvenirs de violences à distance. Ce qui semble primordial cependant, c’est que le silence était un mécanisme d'adaptation culturellement approprié pour gérer leurs souvenirs de violences » (« One motivation of their silence may have been that Mutara, Diane and Flore resist talking about their violent experiences with me to help keep their violent memories at bay. More importantly, however, silence was a culturally appropriate coping mechanism for managing their violent memories » ; Burnet 2012, 116).
C’est précisément là tout l’argument d’Assumpta Mugiraneza, qui insiste sur la dimension culturelle du silence dans l’expression de soi des Rwandais·es, comme un moyen de dire son émotion (ou de ne pas la dire justement). Analysant la manière rwandaise traditionnelle de réagir à une émotion, elle affirme :
« On ne va pas hurler, on pleure en silence : on dit des hommes que leurs larmes coulent à l’intérieur, parce que l’expression des sentiments à l’extrême n’est pas chose courante chez les Rwandais. Quand il va falloir trouver un mot qui tente de partager une expérience douloureuse, il y aura la gestuelle, il y aura beaucoup de silence, et il y aura des mots très chargés qui permettent la pudeur, mais en même temps permettent aussi de dire les choses dans leur entièreté » (Mugiraneza 2014, 124).
Cette manière de conserver le silence face à l’émotion, afin de la contenir, est également fort justement exprimée par le dicton rwandais flanqué en épigraphe du roman de l’auteure rwando-française Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants dispersés, et qui en constitue le fil narratif, à coups d’images répétitives : « le cou est le couvercle du chagrin » (Umubyeyi Mairesse 2019). Le silence abyssal des personnages est dans ce roman rendu par l’image obsédante de l’emmurement de la parole dans le corps dépeint comme un puits bouché par le couvercle de la gorge.
Mais comment, dans la création littéraire ou théâtrale, « dire les choses dans leur entièreté » dans et par le silence, ou bien malgré lui, quand il domine dans les interactions ordinaires ou quand il s’impose à soi par nécessité de se protéger ou par réaction à une menace planante émanant des autorités ? Ou bien, comme le rappelle si justement Ariane Zaytzeff, quand ce silence s’inscrit en creux de la parole commanditée à travers une forme de témoignage formaté pour les besoins de l’entreprise mémorielle : « […] il existe finalement peu d’espaces de parole en dehors des cadres légal et commémoratif et la prise en charge des témoignages par le gouvernement au niveau national engendre une uniformisation de la parole » (Zaytzeff 2017, 469).
Les intervenantes se rejoignent sur ce point : il y a urgence à réinventer un langage. Un langage qui permettrait de libérer les traumas tout en protégeant, un langage artistique qui incarnerait le renouveau que la société post-génocidaire appelle de ses vœux. La question de la langue de création est cruciale dans cette exploration à trois voix du tissage d’une parole scénique à vocation cathartique. Y sont discutés les potentialités, les risques et les contraintes de l’usage du français, de l’anglais et surtout du kinyarwanda. Assumpta Mugiraneza explique qu’il y a une difficulté aujourd’hui à trouver les mots justes en kinyarwanda pour exprimer diverses choses, y compris les plus ordinaires, tant la langue a été blessée par les usages mortifères et criminels qui en ont été faits lors du génocide et même bien avant, durant les événements qui y conduisirent. Elle en veut pour exemple la connotation du verbe « gukora », « travailler », dont on connaît l’usage dévoyé par les miliciens Interahamwe qui, s’en allant massacrer leurs voisins chaque matin, disaient qu’ils allaient « travailler »/« au travail ».
La réinvention de la langue va de pair avec la réinvention de la société, ce « New Rwanda » promu et mis en œuvre par le gouvernement de Paul Kagame depuis plus d’un quart de siècle. Il s’agit de rebâtir une société nouvelle en s’enracinant dans un substrat prétendument ancestral, c’est-à-dire en s’appuyant sur des concepts issus du Rwanda pré-colonial auxquels on insuffle une énergie nouvelle, et qu’on va réinvestir sémiotiquement selon les priorités établies pour la nouvelle société. Assumpta Mugiraneza et Benjamin Chemouni, dans leur article sur les chants patriotiques du FPR, montrent bien que la lutte majeure du FPR une fois au pouvoir a consisté à en finir avec « le siècle de honte du Rwanda », ce qui a eu pour principale implication politique la revivification des valeurs traditionnelles rwandaises comme antidote au sort funeste du pays. En conséquence, écrivent-ils,
« dans les deux dernières décennies, le Rwanda a vu fleurir une profusion d’institutions traditionnelles réinventées, les soi-disant solutions : “fait maison”. Cela comprend les tribunaux gacaca, le programme de répartition du bétail girinka, les camps d’éducation civique itorero, le fonds souverain agaciro […] ce qui a cours en réalité, c’est une talentueuse réinvention menée par le gouvernement, et souvent une expérimentation intégrale davantage qu’un rétablissement d’activités du passé pré-colonial populaire. »
« in the last two decades, Rwanda has seen a profusion of reinvented “traditional” institutions, the so-called “home-grown” solutions. These include for example the gacaca courts, the girinka livestock distribution programme, the itorero civic education camps, the agaciro sovereign fund […] what actually goes on is a skillful government-led reinvention, and often the plain experimentation rather than a recovery of activities from the popular pre-colonial past. » (Mugiraneza et Chemouni, 2019, 22.)
Tout comme le « Nouveau Rwanda » est fréquemment comparé à un laboratoire d’élaboration politique qui passe notamment par une réinvention sémantique et conceptuelle, la littérature et le théâtre, la plume et le plateau, fonctionnent au Rwanda comme autant de laboratoires où réinventer un langage artistique. D’ailleurs Assumpta Mugiraneza (2014) convoque le poète Paul Celan pour lequel il fallait réinventer la langue après le génocide et, dans le même esprit, Adorno qu’elle paraphrase ainsi dans notre table-ronde : « La poésie après Auschwitz, elle n’est pas interdite, elle est prescrite même, mais on ne peut plus la faire comme avant. »
Face à ce silence ambiant et à un tel cadrage de la parole, à une telle re-prise de la langue par les autorités, la tâche est ardue pour les artistes de la parole œuvrant dans le monde du théâtre au Rwanda. L’on comprend dès lors que dans un cadre énonciatif si contraint, elles et ils ont à cœur de se mettre au diapason des voix qui s’élèvent pour dire l’intime de la violence subie, au travers de vibrants témoignages20. Mais elles et ils ont également su se mettre à l’écoute du silence et lui donner toute sa place sur scène, ainsi qu’en témoigne C. Karemera évoquant la création, avec la compagnie Uz et Coutumes, du spectacle Hagati Yacu : « Et puis alors après, de laisser des espaces pour le silence, parce qu’il est des choses que l’on ne peut pas simplement décrire, les mots se heurtent à la violence du vécu qui est encore… parce que les gens continuent à vivre le génocide jusqu’à aujourd’hui. Voilà le deuxième tableau. »
C’est à la fois ce dont les intervenantes ont témoigné lors de cette table-ronde, et à la fois ce qu’elles performent d’une certaine manière, par leur parole abondante et généreuse sur leurs pratiques de créatrices et de spectatrices avisées.
Il n’est d’ailleurs sans doute pas anodin que la richesse de cette conversation soit aussi due au fait qu’elle se soit tenue en français, au Kenya – et non au Rwanda – avec trois femmes vivant au Rwanda, dont deux Rwandaises francophones natives et qui, au Rwanda, s’expriment en anglais par convention ou diligence, mais qui entretiennent en revanche une relation différenciée avec le kinyarwanda (Assumpta Mugiraneza le maîtrisant jusqu’au registre soutenu, Carole Karemera en ayant une connaissance plus sommaire), cette langue étant du reste rarement la langue principale des débats tenus dans la sphère artistique et culturelle au Rwanda. Autrement dit, la langue (française, et non anglaise) et le lieu (décentré) des échanges ont très certainement influé sur la teneur, la profondeur et l’exactitude des propos tenus.
La scène théâtrale transnationale à propos du Rwanda : une pluralité d’esthétiques et l’éthique en question
Cette conversation offre une remise en perspective unique sur l’esthétique des spectacles « globaux », ces spectacles transnationaux sur le génocide – certains conçus au Rwanda, d’autres au Nord mais tournant au Rwanda – et sur leur réception dans le contexte rwandais. Ces propos offrent ainsi, souvent en creux, un aperçu des orientations artistiques des artistes rwandaises installées au Rwanda, concevant elles-mêmes leurs spectacles dans le cadre de collaborations transnationales, avec d’autres artistes du continent (c’est notamment le cas de Kiki, comme on le verra ci-dessous), ou, plus fréquemment, avec des artistes européen·ne·s et américain·e·s. Ce corpus de spectacles s’inscrit en fait dans le registre d’une scène transnationale rayonnant à partir de l’Est de l’Afrique – brillamment décrite par Laura Edmondson (2018) dans Performing Trauma in Central Africa: Shadows of Empire – dont le fonctionnement repose sur la co-création de spectacles entre artistes du Nord et artistes du Sud, condition sine qua non pour obtenir des financements de bailleurs à l’heure actuelle, bailleurs essentiellement situés au Nord (Organisation de la francophonie, agences onusiennes…).
Pour autant, en dépit du caractère foncièrement transnational de toutes les créations abordées, la lecture de cette retranscription fait apparaître une différence majeure entre les spectacles conçus par des dramaturges européen·ne·s et ceux conçus par des dramaturges rwandais·es ; ceci étant corroboré par mes observations personnelles de ces spectacles transnationaux comme de la littérature rwandaise. En effet, autant les textes de la plupart des écrivaines et dramaturges rwandaises de Kigali font résonner le silence des personnages et témoignent d’une sorte d’évitement de la parole crue, du récit factuel du génocide dans la concrétude du macabre, autant les textes issus d’une collaboration artistique transnationale ont tendance à aborder plus frontalement l’événement. Les spectacles transnationaux au sujet du génocide sont légion, le génocide perpétré contre les Tutsi, officiellement désigné comme étant le « dernier génocide du xxe siècle » ayant attiré une foule d’artistes venant principalement d’Europe et d’Amérique du Nord, et animés par des motivations diverses.
Il est donc question dans la conversation de ces spectacles transnationaux que l’on pourrait qualifier d’« exogènes », c’est-à-dire conçus et produits par des Européens : Rwanda 94 du Groupov, Hate Radio de Milo Rau (2012), ou encore Hagati Yacu/Entre nous (2013) et Ejo N’Ejo Bundi (2018) de la Compagnie Uz et Coutumes, autant de spectacles connus du public européen et reconnus, c’est-à-dire salués, légitimés par la critique et les institutions théâtrales européennes. L’analyse, par les intervenantes, des conditions de production de ces spectacles et de leur réception dans le contexte rwandais contemporain, par le public rwandais, permet de revoir à nouveaux frais leurs forces mais surtout leurs limites, d’indiquer leurs lignes de faille.
Citons pour exemple le cas-limite de Hate Radio, un spectacle de Milo Rau, metteur en scène suisse-allemand fondateur de l’International Institute of Political Murder, basé à Zürich, Berlin et Gand. Cette structure au nom de think tank ou d’institution de recherche et d’enseignement est bien une compagnie de théâtre et de film spécialisée dans le théâtre politique et le « real theatre », une sorte de théâtre documentaire multimédia accompagné de débats avec le public21. Carole Karemera évoque dans cette conversation les échanges qu’elle eut avec le metteur en scène et Assumpta Mugiraneza au sujet du montage du spectacle à Kigali. Fidèle à son esthétique de « théâtre réel », le projet de Milo Rau était de re-créer, sur le lieu des massacres, dans la capitale du Rwanda, le studio de la RTML, la Radio-télévision des Mille Collines, ce média qui contribua de manière très efficiente au génocide en diffusant des messages haineux envers les Tutsi, mais aussi des listes de noms de personnes à abattre et autres programmes divertissants destinés à galvaniser les tueurs (voir Chrétien 2000). Craignant que le principe de « reconstitution » de l’événement, ce re-enactment22 cher à Milo Rau (Wind 2017), ne re-traumatise les spectateurs, à peine vingt ans après le génocide, A. Mugiraneza et C. Karemera avaient préconisé la mise en place d’un dispositif visant à encadrer la production afin de préparer le public mais aussi de le contenir – littéralement – dans l’espace confiné et dédié du Kigali Genocide Memorial Center, au sein de l’« aquarium », ainsi que C. Karemera nomme la salle des archives. Ce dispositif d’aquarium, qui figurait de manière évidente l’espace d’un studio radio et isolait du même coup le laboratoire de la haine23, le contenant dans un bocal loin des spectateurs mais soumis à leur regard scrutateur, a d’ailleurs été recréé dans les spectacles conçus en Europe.
D’autres spectacles imaginés dans un premier temps par des artistes basés en Europe, quoique cherchant également, à l’instar de Milo Rau, à atteindre le cœur du mécanisme génocidaire en dépit du risque psychologique ainsi induit, ont pourtant invité les artistes rwandaises à appréhender l’événement sous un angle indirect et pour autant puissant. Évoquant le spectacle Hagati Yacu, C. Karemera nous confie que « ce qui [la] touchait d’abord beaucoup c’était la simplicité, la recherche vraiment des rapports humains avant, pendant, et potentiellement après le génocide ». Le traitement du voisinage, aspect crucial et singulier du génocide des Tutsi au Rwanda24 est en effet au cœur du spectacle :
« Hagati Yacu, au début ça commence avec des voisins – et ça c’est quelque chose, tout le monde a des voisins avec lesquels on a parfois des heurts – et ça racontait de manière très symbolique et très simple la proximité entre tueurs, victimes et cetera, ce passé commun – ce n’est pas des gens qui sont venus de l’extérieur nous tuer, c’est des gens avec qui on se passait le lait, le sel, chez qui les enfants allaient dormir25… »
Autre exemple de spectacle qui cherchait à appréhender la teneur de l’expérience du génocide tout en l’abordant de biais : l’adaptation de L’Espèce humaine (1947) de Robert Antelme par la metteuse en scène française Maylis Isabelle Bouffartigue (Compagnie Monsieur Madame), interprété par Diogène Ntarindwa, dit Atome, comédien rwandais qui joue également dans Hate Radio. Raconter le mécanisme d’un certain génocide dans les lieux où sévit un autre génocide, une cinquantaine d’années auparavant, tel était le pari de la compagnie. La pièce fut jouée pour la première fois à la troisième édition du festival Buja sans tabous à Bujumbura au Burundi, où la logique génocidaire aurait également pu résonner. En réalité, il n’en fut rien, les extraits choisis du texte de Robert Antelme étant d’une froideur clinique et les détails d’une grande précision livrés par le narrateur relevant de l’expérience concentrationnaire propre aux méthodes du Troisième Reich, en ceci éloignées du génocide des Tutsi au Rwanda ou des massacres à caractère ethnique au Burundi26.
A contrario, les spectacles que l’on pourrait qualifier d’« endogènes », soit ceux conçus par les femmes de théâtre de Kigali, portent davantage sur le ressenti de l’après-catastrophe, le processus de deuil, le chagrin, la nécessité de forger, peu à peu, une mémoire de l’événement. C’est ce lent et délicat processus que relate Carole Karemera dans la table-ronde27. Elle raconte comment la sidération de l’immédiat après s’est peu à peu dissipée lors des veillées de parole où les returnees (les « retourné·es », ces Rwandais·es de la diaspora, né·e·s en exil, qui n’avaient pour la plupart jamais pu mettre le pied au Rwanda et qui sont venu·e·s s’y installer aux lendemains du génocide) se sont mis·es à l’écoute des rescapé·e·s et ont appris à « prendre leur chagrin sur le dos », comme le dit l’expression en kinyarwanda (voir Carole Karemera, retranscription de la table-ronde, section 1.1). Instaurer, au Rwanda post-génocide, la pratique théâtrale, constitua ainsi une entreprise longue et patiente. Elle relate le laborieux défigement des corps corsetés par la peur et le traumatisme qui accentuaient encore une forme de réserve des Rwandais, liée à une introversion culturelle. Il fallut aussi apprivoiser les peurs de leurs congénères pour favoriser la libération des émotions enfouies dans ces corps traumatisés et vaincre la défiance vis-à-vis de la parole et des artistes de la parole, les mots ayant servi à tuer sur chaque parcelle des mille collines. L’écrivain d’origine tchadienne Koulsy Lamko, venu au Rwanda par le biais de Fest’Africa, qui créera à l’Université nationale du Rwanda à Butare le Centre universitaire des Arts et qui le dirigera durant une dizaine d’années, s’attellera entièrement à cette tâche. Il formera certain·e·s des interprètes et gens de théâtre les plus dynamiques tels qu’Odile Gakire Katese (voir infra) ou encore Diogène Ntarindwa.
Puis vint la quête collective de sens pour tâcher de s’expliquer ce qui s’était passé, pour vaincre aussi la honte d’être rwandais·e. Une fois ces processus préliminaires engagés, il s’est agi en premier lieu de donner la parole aux morts, de leur faire une place sur le plateau, afin de lutter contre l’oubli conçu comme l’enfouissement définitif qui scellerait une disparition intégrale de leur existence après leur mort tragique dans d’atroces souffrances. Cette adresse s’est accompagnée d’une quête de sens esthétique, d’une remise en question des formes héritées et traditionnelles, notamment du dispositif théâtral classique de type frontal.
Recréer du lien avec les morts, c’est également tout le sens du travail d’Odile Gakire Katese (dite Kiki), dont nous entretient Ariane Zaytzeff dans la table-ronde, au sujet de deux spectacles. Le premier est La pluie et les larmes ou Ngwino Ubeho (du kinyarwanda, « Viens et sois en vie »), écrit par Odile Gakire Katese du Centre universitaire des arts du Rwanda à Butare/Huye, chorégraphié par la togolo-française Flora Théfaine de la Compagnie Kossiwa, sur une musique du compositeur burkinabé Alif Naaba, à l’occasion de la quinzième commémoration en 2009. Pièce essentiellement chorégraphique mettant en scène des femmes tambourinaires, des danseurs et des chanteurs interprétant des chants en kinyarwanda et en kiswahili, le spectacle fait entendre une narration en français, énoncée par une comédienne, qui est une adresse aux morts, un hommage à leur vie par le don de la beauté performée sur le plateau. L’ensemble – textes et scénographie – est éminemment poétique. Le sujet, quoiqu’infiniment douloureux, est sublimé par l’amour et la générosité de l’adresse aux morts. En outre, en faisant jouer sur scène des femmes tambourinaires (sachant que l’art du tambour est traditionnellement dévolu aux hommes), Kiki, à l’instar de C. Karemera, endosse elle aussi la responsabilité d’interroger les formes d’art héritées et les formes d’arts traditionnelles, dans la perspective de proposer une forme singulière, qui réponde au besoin de créativité requise pour inventer, au niveau artistique, les formes du nouveau Rwanda. Ariane Zaytzeff considère que l’alliance transculturelle de cette création spectaculaire pluridisciplinaire permet de « conjure[r] le passé au sein d’un présent marqué par l’absence » (Zaytzeff 2015, 91), et de faire « déborder » la mémoire du génocide du discours officiel, en tissant une mémoire intime de l’événement, en créant un lien émotionnel avec les disparus comme avec les spectateurs : « En cherchant à dire ce qui est absent du discours officiel, ce sont les absents eux-mêmes qu’elle appelle afin de les réintégrer dans la reconstruction du présent » (ibid., 92).
L’autre création – toujours in-progress – de Kiki, The Book of Life, déjà évoquée, convoque également les morts à travers des lettres réelles qui leur sont adressées par leurs proches rescapés du génocide. Il s’agit de raconter publiquement l’histoire de ces personnes assassinées en masse et qui, sans cela, seraient condamnées à l’anonymat. Parler d’elles sur scène est une manière de lutter contre le néant provoqué par leur absence. Énoncer le nom des morts, raconter leur histoire pour ne pas les oublier, tel est le sens de la quête du personnage de théâtre « testamentaire » (Banu 1993, 180), telle Joséphine dans Littoral de Wajdi Mouawad (1999). Collectant les bottins des villages dévastés par la guerre (du Liban), elle arpente la région, lestée de ses sacs remplis de noms et d’adresses des disparus et elle s’échine à retenir les noms des disparus de villages dont elle n’a pas retrouvé les bottins.
Cependant, The Book of Life va au-delà de l’énonciation et du testamentaire. En effet, l’adresse des scripteurs à leurs morts dans ces lettres lues sur scènes sont pour certaines d’une intensité telle que les scripteurs semblent s’adresser à des vivants susceptibles de leur répondre. Analysant l’expression de ce désir de performativité qui n’est pas sans générer un certain trouble chez les spectateurices, Ariane Zaytzeff conclut : « En demandant aux participants des ateliers d’écrire aux morts, Gakire leur a donné la possibilité d’écrire leur impossible retour à la vie, auquel les lecteurs participent par leur acte de lecture » (Zaytzeff 2017).
Outre Carole Karemera et Kiki, les participantes de cette table-ronde convoquent également une troisième femme de théâtre, tout aussi importante que ses consœurs dans la dynamique théâtrale rwandaise : Hope Azeda. Dans le triumvirat des papesses du théâtre au Rwanda, Hope Azeda occupe à cet égard une place singulière et une place à part. En effet, contrairement à Carole Karemera, née et grandie en Belgique francophone et à Kiki, née et grandie au Congo, Hope Azeda a grandi en Ouganda et a été socialisée dans les réseaux anglophones du monde de la scène. Le danseur et comédien Yannick Kamanzi, qui jouera dans des créations de H. Azeda comme de C. Karemera, dira d’ailleurs de ces deux artistes qu’elles se « répartissent équitablement et intelligemment » la scène théâtrale actuelle au Rwanda, l’une côté francophone, l’autre côté anglophone, sans marcher sur les plates-bandes de la consœur28. Azeda occupe aussi une place à part puisque son théâtre apparaît comme une forme épousant plus étroitement les lignes du discours officiel du gouvernement rwandais. En effet, en 2004, à l’occasion de la dixième commémoration, elle créera, à la demande de AEGIS Trust International (une ONG britannique dédiée à la prévention des génocides, influente au Rwanda) et du ministère de la Culture du Rwanda, le spectacle Rwanda My Hope (spectacle principalement en anglais avec un peu de kinyarwanda), qui « retrace les événements du génocide à travers l’histoire de plusieurs rescapés, évoque ensuite leurs espoirs pour le futur et finit sur une note positive avec des danses traditionnelles de célébration » (Zaytzeff 2015, 85).
Dans son article, Ariane Zayzeff montre bien combien cette pièce de théâtre reprend le discours officiel : « certains des témoignages mis en scène sont pris presque mot pour mot des panneaux du Kigali Genocide Memorial, le mémorial principal et le plus visité, financé et géré par Aegis Trust » (ibid., 86). Dix ans plus tard, Hope Azeda se voit commanditer par la présidence le spectacle officiel de la vingtième commémoration. Ce sera Shadows of Memory, spectacle présentant la même configuration linguistique que le précédent, préparé sous haute surveillance des autorités avec une exigence encore plus haute (retracer l’histoire millénaire du Rwanda en 20 minutes), et qui reprendra parfois textuellement des fragments du précédent spectacle. Ces deux spectacles furent joués dans le stade Amahoro où se déroule chaque 7 avril la cérémonie officielle annuelle de lancement de #Kwibuka29. Des performances d’Hope Azeda, Ariane Zaytzeff en conclut que « figées dans le cadre officiel, [elles] semblent condamnées à réitérer le discours officiel et à se réitérer elles-mêmes » (ibid., 88).
Toutefois, cette tendance, Hope Azeda est la seule à l’incarner, du moins la seule visible sur la scène rwandaise transnationale, celle qui s’exporte ou bien bénéficie de collaborations internationales30. Cette tendance à aborder le génocide de biais, à suggérer le silence, à le figurer poétiquement comme un abysse tapi dans l’ombre, se retrouve aussi dans les fictions narratives des écrivaines rwandaises de Kigali, telles Dominique Celis et Natacha Muziramakenga.
Le génocide dévore l’espace des personnages, il colonise leur intimité par un amoncellement de non-dits et de secousses qui viennent les ébranler sans crier gare, comme autant de traces héritées ou de réminiscences des horreurs portées par les leurs.
Dans « Retours impossibles », la nouvelle autobiographique de l’écrivaine rwandaise née en République démocratique du Congo, Natacha Muziramakenga (2019), le génocide est présenté comme une déflagration à effet différé : il agit sur la narratrice comme par ricochets de la douleur d’une perte intime à la douleur d’une meurtrissure collective. C’est en effet son retour à Lubumbashi, où elle naquit et grandit en exil et d’où elle suivit lointainement, enfant, le déroulement du génocide dans le pays d’origine de ses parents, qui provoque la réminiscence de la perte de sa mère, décédée au Congo. Cette perte est irrémédiablement associée à la perte des siens, tués massivement lors du génocide, et au lien (dis)tendu avec son pays natal, frère ennemi du pays d’origine de la famille, où elle a choisi de s’installer. De même, Ainsi pleurent nos hommes, le roman de la Belgo-rwandaise Dominique Celis (2022), met en scène un personnage nommé Erika, qui ouvre le lecteur et la lectrice aux affres des personnages menant tou·te·s une vie qu’ils veulent ordinaire mais qui est irrémédiablement marquée par l’histoire récente et la place de chacun – réelle, projetée, imaginée – vis-à-vis de cette histoire31. À travers l’histoire intime amoureuse et familiale de la narratrice dans un Rwanda contemporain, post-génocide en pleine reconstruction, se donnent à lire les éclats diffractés de leurs « abîmes », de ses propres « béances » face à ce qu’elle appelle « une dévastation » (Celis 2022, 7).
Tous tes enfants dispersés, premier roman de la nouvelliste Beata Umubyeyi Mairesse (2019), fait également entendre les douloureux impacts du génocide sur les membres d’une famille durablement déchirée par l’événement. Ce roman à forte teinte autobiographique – l’écrivaine est, comme la narratrice, une Franco-rwandaise installée à Bordeaux et qui vécut à Butare/Huye jusqu’aux premiers jours du génocide – propose en réalité une sorte de variation sur le poids écrasant du silence. Les non-dits assortis de leur lot de frustrations, peurs, chagrins, amertumes, hontes envahissent les relations filiales et fraternelles, au point d’être fatales aux personnages.
À les entendre, à les lire et à les relire, ces femmes de théâtre du Rwanda nous disent combien délicat est le tissage d’une parole poétique, d’une diégèse théâtrale, d’une forme spectaculaire concernant le génocide en tant que tel ou même l’ère post-génocide. Combien il faut se prémunir de dispositifs préparatoires pour tâcher d’endiguer au mieux la violente souffrance de celles et ceux qui sont en contact avec la scène : public comme interprètes, danseurs et danseuses, comédien·ne·s. Instaurer des temps de dialogue, aménager des espaces dédiés à l’échange sur l’expérience et le ressenti de chacun·e, savoir écouter et prendre en compte, savoir prendre le temps d’introduire petit à peu la création artistique dans le paysage rwandais, savoir se saisir des propositions extérieures sans les imposer ou les accepter d’un seul élan… Autant de précautions qui ont permis d’aboutir, pour l’essentiel, à des créations sensibles et poétiques abordant souvent de biais l’atrocité de l’événement, quand un certain nombre de créations imaginées en dehors du Rwanda par des non-Rwandais ont cherché, a contrario, à percer à jour les rouages de la haine. Ce décalage entre les deux approches s’explique sans doute par l’adresse au public telle qu’on se l’imagine, au Rwanda et en Occident. À l’origine d’une initiative théâtrale autour du génocide dans les mises en scène occidentales, il y a toujours a minima une forte sensibilité à l’événement, voire une fêlure personnelle qui vient lui faire écho. La souffrance d’autrui ressentie s’accompagne bien souvent d’une indignation, d’une colère vis-à-vis de l’ignorance de leurs pairs voire de la complicité de leurs dirigeants. C’est donc tout naturellement qu’ils vont chercher à frapper l’esprit de leur public imaginé qui est en premier lieu constitué de leurs congénères.
Lorsque les intervenantes évoquent ces créations exogènes, c’est la question de la légitimité qui est soulevée en creux, laquelle est adressée plus généralement à tou·te·s les artistes qui entreprennent un travail mémoriel. Carole Karemera, en tant que Rwandaise « retournée » et non rescapée, évoque son hésitation à endosser le rôle de passeuse de mémoire. Assumer un rôle de témoin serait une imposture ; il doit revenir aux rescapé·e·s, comme Yolande dans Rwanda 94. L’historienne Hélène Dumas relate même la maxime irrémédiablement attachée à l’expérience des rescapés depuis 1994 : « Ijoro ribara uwariraye », « Seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter » (Dumas, 2020, 932).
La conversation sur le statut de la parole et de celle ou celui qui l’énonce conduisent ainsi à une réflexion collectivement menée sur l’éthique de la pratique de comédien·ne : qui, finalement, est habilité à dire l’horreur de l’événement, qui peut jouer/interpréter les victimes ? Les victimes elles-mêmes et les témoins, mais dès lors que « personne ne témoigne pour le témoin », ainsi que le regrettait déjà Paul Celan en son temps (« Gloire de cendres » [1964], in Celan 2003, 78), la littérature et le théâtre, via les artistes de la parole et de la scène, peuvent le faire. Manière d’inviter les artistes de la parole à se saisir de cette parole pour décharger un peu les victimes et les témoins de leur fardeau, afin de « prendre un peu de leur douleur sur leur dos », ainsi que le formule C. Karemera, d’après l’expression consacrée en kinyarwanda.
Conclusion et ouverture : la conversation publique comme source
Afin d’expliquer en quoi la transcription de cette table-ronde constitue une source concernant la constitution d’un corpus globalisé de créations théâtrales sur le génocide au Rwanda et sur le mode d’incarnation des textes de type témoignages et récits de soi, je commencerai par indiquer en quoi ce document fait source pour moi, puis je livrerai quelques suggestions quant à la manière dont il peut être utilisé comme source pour d’autres chercheur·e·s en sciences humaines travaillant sur le Rwanda/au Rwanda, ou même pour des chercheur·e·s en théâtre, performance et littérature dans des contextes de (post)violences politiques.
En premier lieu, je considère ce document – transcription d’une conversation qui s’est tenue en public, dans un cadre académique – comme une source, compte tenu de ma difficulté (évoquée en introduction) à m’entretenir avec ces femmes de théâtre. En dépit de nombreux séjours à Kigali et de mon insistance à m’entretenir avec elles, mes demandes d’entretien ont été soit éconduites, soit ignorées. J’ai simplement pu croiser Carole Karemera à de nombreuses reprises, en général sur le lieu de ses créations ; et j’ai également eu la chance de rencontrer Kiki dans un cadre privé chez Ariane Zayzteff. J’ai ainsi pu échanger avec elle de manière informelle, mais elle n’a pas donné suite à ma proposition d’entretien plus formel. Quant à Hope Azeda, nous nous sommes rencontrées brièvement lors du festival qu’elle a fondé et dirige, Ubumuntu, mais elle n’a pas donné suite à mes sollicitations33.
Aussi, pouvoir ainsi bénéficier de la finesse, de l’intelligence et de la générosité de Carole Karemera dans ce cadre particulier, en dialogue avec des consœurs qui ne sont pas exactement ses alter ego (ni Ariane ni Assumpta ne sont metteuses en scène et directrices de compagnie théâtrale), mais néanmoins des personnes du milieu artistique et intellectuel rwandais était une chance et un enrichissement certain pour moi. Sa parole était forcément adaptée à une audience publique, et l’on peut supposer qu’elle aurait différente dans un cadre d’emblée plus privé, en face-à-face. Pour autant, d’une certaine manière, le cadre de cette table-ronde – public très dispersé mais très attentif, atmosphère feutrée –, la familiarité des intervenantes entre elles et la délicatesse du sujet, ces conditions réunies ont généré une fluidité dans les échanges, une sincérité dans le partage qui conféraient une franche impression d’intimité. C’est d’ailleurs parce que nous, organisatrices comme intervenantes, étions unanimes quant à la qualité de l’échange, la profondeur du dialogue, l’humanité des propos, le souci d’une transmission juste et sensible de l’expérience de chacune comme du vécu et de la réception des Rwandais·es vis-à-vis de ces questions, l’écoute et le respect mutuel des intervenantes, que nous avons souhaité rendre compte de ce moment d’échange, unique à mes yeux, dans le cadre de mon terrain.
La transcription de cette conversation peut en effet aussi être considérée comme une source pour ma recherche en ce qu’elle permet, par un échange inédit entre des personnes centrales du champ investigué, d’inscrire dans un temps plus long que celui de mes observations de terrain (2018-2021) les créations artistiques au Rwanda/du Rwanda, toutes celles dont il est question dans cet échange et qui s’inscrivent dans une scène théâtrale mondialisée, « transnationale » comme le dit L. Edmondson (2018). Relire ce texte m’a permis par exemple de mieux appréhender le spectacle de Mashirika Theatre Company de Hope Azeda concocté, dans le cadre d’une collaboration avec des Américains et des Britanniques, pour la vingt-cinquième commémoration en avril 2019, soit quelques mois après que se soit tenue cette conversation à Nairobi. Intitulé Generation 25, ce spectacle de type comédie musicale à l’américaine s’inscrivait dans la ligne officielle de cette vingt-cinquième commémoration qui ciblait la génération actuelle, celle de tou·te·s ces Rwandais·es du Rwanda, nombreux·ses, qui sont né·e·s après le génocide, et qui veulent aller de l’avant, se concentrer sur l’avenir à bâtir. J’avais été surprise par l’aspect premier degré du discours énoncé et chanté par les performeurs, qui m’avait initialement semblé être une pure chambre d’échos du discours officiel du gouvernement. Cela était aussi sans doute dû au genre de la comédie musicale à l’américaine dans lequel s’inscrivait délibérément ce spectacle et qui s’explique par la formation anglophone de Hope Azeda et ses nombreuses collaborations avec des structures culturelles et caritatives américaines. Dans un second temps, relisant cet échange, j’avais mieux compris les choix esthétiques de la metteuse en scène, en percevant comment ils s’inscrivaient dans l’histoire et le fonctionnement de la troupe qu’elle a fondée. Puis, dans un troisième temps, j’ai pu mettre en regard mon expérience de spectatrice et les données livrées par les intervenantes de la table-ronde au sujet du monde de la scène au Rwanda, avec la réception du spectacle par mon collègue Bobby Smith qui réfléchit comme moi, et avec moi, aux questions de mise en scène des violences politiques, de réconciliation, prévention ou réparation des blessures et préjudices par le théâtre, mais aussi à la prégnance d’une forme de silence et de parole autorisée dans des contextes de (post-)violences politiques. Il m’avait fait voir, en creux, des reprises évidentes du discours officiel, la relative audace de certaines répliques qui questionnaient certains aspects du discours officiel, révélant une complexité au premier abord insoupçonnée, et dont les intervenantes de la table-ronde ne semblaient pas convaincues. Aussi, relisant encore cet échange, cette transcription, tandis que je travaillais avec Bobby Smith sur son article dans le cadre d’un dossier spécial « Théâtre, performance et parole politique dans l’espace public » que je co-éditais (Smith 2022), je percevais mieux combien cet échange dans cette table-ronde entre une des trois principales femmes de théâtre, et ses acolytes connaissant parfaitement la scène théâtrale rwandaise, avait pu aussi être l’occasion de se positionner chacune dans le champ artistique rwandais, y compris idéologiquement, tant vis-à-vis des collaborations extérieures (ici françaises, belges, suisses), que vis-à-vis des autres artistes de la place et des injonctions généralisées à la réparation ou à la réconciliation. Les échanges – surtout dans le dernier temps de la table-ronde – laissent en effet affleurer, sinon une forme de rivalité entre les unes et les autres, en tous les cas, des divergences tant dans les pratiques et les esthétiques choisies que dans les modalités de collaborations transnationales.
Enfin, à la lecture de cette conversation croisée et de cet article, il est loisible de s’interroger sur la valeur de cette transcription de table-ronde, au-delà de l’usage personnel que j’en fais pour ma propre recherche : en quoi peut-elle être considérée comme une source pour des chercheur·e·s en littérature et arts de la scène et pour les chercheur·e·s en sciences humaines travaillant sur le Rwanda/au Rwanda ?
Il me semble que ce document vient se positionner en miroir des textes sur le Rwanda post-génocide ou sur le génocide vécu depuis l’exil, des textes aujourd’hui publiés, disponibles pour les chercheur·e·s. À l’instar des tables rondes autour de la parole sur le génocide organisées à Paris en 2015, « Articuler un langage de l’âme »34, la conversation réfléchit en effet les grandes questions brassées par ces textes littéraires ou même les narrations cinématographiques et les productions théâtrales transnationales à propos du génocide35. Elles sont ici explorées densément, discutées sans fard, illustrées par des exemples concrets et des anecdotes inédites concernant les processus de création et la réception du public rwandais à ces spectacles transnationaux et à ces fictions mondialisées du génocide.
Au terme de ces deux heures et demi de conversation (et vingt-cinq pages de retranscription intégrale) au sujet de la possibilité d’une parole adaptée et d’une scénarisation possible du génocide et de ses corollaires sur la vie sociale, la question, néanmoins, subsiste : est-il possible, au Rwanda, de « réparer une maison de briques sans ciment », comme le dit Carole Karemera ? Ne s’agit-il pas avant tout, pour les artistes de la scène et de la parole, encore aujourd’hui, de faire exister la mémoire de celles et ceux qui ont vécu cet événement en « assemblant les petits morceaux » de ce qui subsiste, des émotions, ressentis et savoirs qui émergent au gré des séances de pratique du spectacle et de dialogue méta-théâtral ? Revient en effet maintes fois dans la conversation – singulièrement à la fin – l’expression unanimement affirmée de la nécessité de conserver les traces des disparu·e·s, par exemple en entretenant leurs maisons et en tâchant d’empêcher leur démolition ainsi qu’exigée par le plan urbain de rénovation de Kigali. Qu’il s’agisse de mettre en scène des récits et témoignages, d’exprimer par la performance non verbale la douleur et l’absence, ou bien encore de mettre en exergue et d’interpréter les récits d’enfants rescapés du génocide, il s’agit de redonner à l’événement sa factualité pour lutter contre un oubli ou un effacement criminel : « Sortir l’événement des limbes d’un discours déréalisant, c’est partir en quête de ses traces imprimées à jamais dans les corps et la psyché des rescapés ; c’est partir à la recherche de stigmates, apparents ou imperceptibles, au sein des paysages ; c’est revenir aux êtres, arpenter collines et marais, écouter le kinyarwanda » (Dumas 2020, 10).
Cette injonction à élaborer une mémoire matérielle de l’événement rejoint d’ailleurs la politique mémorielle qui présida à la construction des mémoriaux, ces édifices officiels dédiés à la mémoire des disparu·e·s. Qu’il s’agisse de murs de maisons ou d’institutions préexistant au génocide et aujourd’hui reconvertis en lieux de recueillement, ou bien de nouveaux édifices bâtis à des fins mémorielles – telles les stèles et autres murs recouverts de noms, ou encore des caves des églises de Nyamata et Ntarama aménagées pour accueillir des ossements –, des échos de la politique mémorielle entreprise au Rwanda sourdent tacitement des propos des intervenantes. Il apparaît ainsi que les politiques et les artistes de la parole et de la scène se rejoignent dans l’élan premier, pour rebâtir une société nouvelle, de coller à la matérialité du génocide, en conservant les traces des massacres mais surtout celles des disparus, afin de rendre l’événement réel (face aux tentatives d’oubli, d’effacement ou pire, de dénégation), et parvenir à une parole qui soit juste, inoffensive et sécurisante, pleine de sollicitude et finalement libératrice.