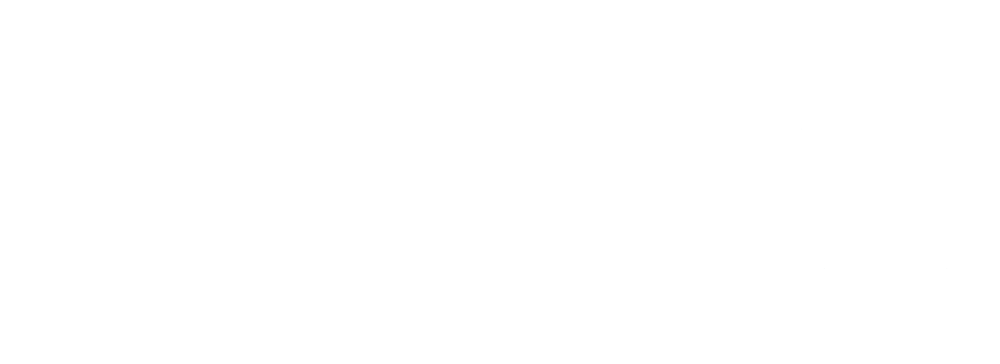Sources. Matériaux & Terrains en études africaines se donne une mission originale au sein des revues universitaires en sciences humaines et sociales : placer au cœur de la réflexion les matériaux de terrain, c’est-à-dire les objets empiriques produits – et le plus souvent coproduits – par les chercheur·e·s dans une situation particulière d’enquête et selon des méthodes spécifiques qui conditionnent le raisonnement et l’élaboration d’énoncés théoriques. Ces matériaux sont de nature très diverse. Il peut s’agir d’archives publiques ou privées – anciennes ou récentes – consultées dans des institutions ou collectées pendant l’enquête ; de productions écrites locales (cahiers, lettres, journaux intimes, autobiographies, tracts, pamphlets, écrits religieux, etc.) ; d’extraits d’entretiens, de conversations, de récits de vie ; de notes, notamment issues d’observations participantes ; de cartes, de schémas, de croquis des chercheur·e·s ou de leurs interlocuteur·trice·s ; d’objets familiers, d’expôts muséographiques ou de regalia ; d’affiches électorales, de pagnes et de chants de campagne ; de photographies, d’enregistrements audio, de films ou de vidéos ; d’extraits de littérature « grise » (rapports, évaluations) ou de presse ; de données tirées d’Internet ou de médias sociaux, etc. Les exemples abondent, toujours relatifs à un objet d’étude, aux questions de recherche qui s’élaborent et se réélaborent à son propos et aux conditions contingentes de l’enquête.
Cette volonté de placer l’empirique au cœur de la réflexion n’est pas le propre de Sources. En anthropologie et en sociologie, nombreuses sont les revues françaises qui donnent la primauté au terrain et, pour certaines d’entre elles, s’interrogent prioritairement sur les conditions d’enquête, comme la revue Terrain. En science politique, discipline qui s’est tournée vers l’investigation empirique plus tardivement et notamment grâce à des chercheur·e·s travaillant sur le continent africain, la revue Politique africaine a proposé pendant longtemps une rubrique « Documents » qui publiait et commentait des sources primaires. L’histoire, constitutivement soucieuse de la critique historique des sources et de la mise à disposition des preuves (Bloch 1949 ; Pomian 1999), porte également une attention toujours plus forte sur les conditions de production des matériaux qu’elle mobilise, sur leur matérialité et sur les sensorialités qui leur sont attachées. La publication récente d’ouvrages de réflexivité sociologique et historienne sur les « grandes enquêtes », à rebours d’une histoire des idées décontextualisée, participe de cette ambition de mieux saisir les conditions d’investigation (Burawoy 2003 ; Laferté, Pasquali et Renahy 2018). L’archéologie également a connu dans les années 1980 un renouveau épistémologique (Gallay 1986), aujourd’hui porté par des revues anglophones comme le Journal of Archaeological Science Reports mais peu visible dans le champ français, en dehors de la revue Ramage qui, née en 1982, voit son dernier numéro sortir en 2001.
Dans cette lignée, mais avec un parti pris plus marqué, Sources souhaite centrer ses réflexions sur les matériaux eux-mêmes, mais aussi permettre leur archivage et leur accessibilité, pour contribuer à l’exposition des sciences humaines et sociales en train de se faire. Le fait que la revue soit née au sein d’un institut de recherche implanté en Afrique, au plus près des lieux d’enquête (Pommerolle 2019), n’est pas non plus anodin. En réaction à une standardisation imposée par les revues universitaires de premier rang, du Nord comme du Sud, il s’agit de proposer une revue dégagée de certaines routines d’écriture et de repartir du monde social observé au plus près, tant par le passé que dans le présent. Cet appel à placer les matériaux au cœur de l’interrogation ne relève pas d’un fétichisme de l’empirique. Le constat a été fait, dans le dernier quart du xxe siècle, d’« une sorte de fuite hors de la théorie, une re-saisie de l’empirisme méthodologique ainsi qu’un renouveau du réalisme1 » (Comaroff et Comaroff 2012 : 47), refuges face aux reflux des grandes théories. En 1959 déjà, Charles Wright Mills raillait les « bureaucrates de l’empirie » (Mills 2015 [1959]) qui, comme le rappelle Jean-Claude Passeron (1991, 1996), produisent à la chaîne et de façon standardisée ce qu’ils conçoivent comme des données brutes et objectives mais sont incapables d’« imagination sociologique », d’inventivité conceptuelle et d’une réflexivité pourtant indispensables à toute tentative d’intellection des phénomènes. Ce n’est donc pas sur la base d’un empirisme naïf mais à partir d’arguments épistémologiques et éthiques forts que la revue Sources fait du centrage sur les matériaux, de leur décryptage et de leur archivage sa ligne éditoriale.
Exposés en première partie de cette introduction, les arguments épistémologiques portent sur la nature des sciences humaines et sociales comme savoir empirique qui requiert l’exigence de la preuve et s’adosse à des règles de la méthode sur la production et l’usage des matériaux. La seconde partie développe l’impératif éthique qui lui est lié et établit les rapports adéquats entre le sujet connaissant et les sujets de la connaissance. Cet impératif est partout valable mais il est d’autant plus impérieux dans les études africaines que la production du savoir y a trop souvent été arrimée – et l’est parfois encore – à des idéologies occultées et des asymétries de pouvoir. La nécessité archivistique d’un centrage empirique, élaborée en troisième partie, repose sur le fait que les matériaux conservés et mis à disposition en accès libre concourent à rendre les données de la recherche consultables par les pairs et par d’autres publics, aujourd’hui et à l’avenir, et simultanément à les rendre objectivement contrôlables, vérifiables, voire réfutables. Nous présentons en quatrième partie la genèse de la revue, revenant sur les différentes étapes de sa constitution, les acteurs qui y ont pris part et les transformations qu’elle a connues. L’ensemble se clôt par la présentation de ce premier numéro, numéro modèle dont les articles visent à incarner les ambitions épistémologiques, éthiques et archivistiques d’une rigueur empirique telle que Sources la promeut2.
Exiger la preuve
Il s’agit en premier lieu de prendre au sérieux les sciences humaines et sociales comme sciences empiriques, c’est-à-dire comme une forme de savoir qui s’applique à l’humain tel qu’il est dans le monde et requiert, pour cela, de produire des données sur ses pratiques et sur les représentations qu’il en construit (Foucault 1966). L’épistémologie réaliste qui fonde cette forme de savoir empirique – sans ignorer les modalisations qu’elle peut prendre selon les disciplines et les approches diverses qui s’expriment à l’intérieur de chaque discipline – s’adosse à des règles de la méthode sur la production et l’usage des matériaux. Ce sont ces règles qui établissent la véridicité des sciences humaines et sociales, autrement dit leur capacité à produire des énoncés vrais, ou plutôt qui sont « dans le vrai » (Canguilhem 1977 ; Balibar 1994) en tant qu’ils remplissent les exigences requises pour asseoir empiriquement l’inférence et la généralisation, c’est-à-dire l’abstraction par concept, et se distinguer ainsi de la doxa : « La véridicité ou le dire-vrai de la science ne consiste pas dans la reproduction fidèle de quelque vérité inscrite de toujours dans les choses ou dans l’intellect. Le vrai, c’est le dit du dire scientifique. À quoi le reconnaître ? À ceci qu’il n’est jamais dit premièrement. Une science est un discours normé par sa réflexion critique » (Canguilhem 1977 : 21).
Si les débats sur les règles de la méthode traversent les sciences humaines et sociales depuis leur naissance et sont une condition de l’enrichissement et de la transformation de la connaissance, la revue soutient que ces sciences, dans leur diversité, n’en possèdent pas moins une unité épistémique : elles partagent des paradigmes similaires et des mêmes modalités de construction de leurs objets d’étude, de production de données et d’élaborations interprétatives (Bourdieu, Chamboredon et Passeron 1968 ; Passeron 1991).
La revue considère trois ensembles de règles de la méthode comme des nécessités qui constituent également des critères de publication. Un premier ensemble porte sur la construction des éléments empiriques en lien avec la manière dont l’objet de l’enquête a été constitué – ce dernier n’étant jamais donné mais toujours construit. Il est tout d’abord impératif d’expliciter les « principes théoriques de construction et de sélection des matériaux » (Lahire 2005) grâce auxquels un corpus est composé. Il importe également de diversifier les matériaux et de les recouper, selon le principe dit de triangulation (Soler 2009). Ces procédures permettent de soutenir la validité d’une proposition en prenant appui sur le recoupement de matériaux de différentes natures. Elles permettent aussi d’identifier des éléments qui n’entrent pas dans le cadre de l’analyse mais, au lieu de les éliminer du champ de la réflexion, de les intégrer théoriquement voire de les utiliser pour faire évoluer le cadre de l’analyse. Elles conditionnent donc, enfin, le processus d’itération, à savoir le va-et-vient entre problématique et terrain, entre interprétation et données, qui est un principe premier de la vigilance épistémologique à l’égard des routines argumentatives, des déficits analytiques et des partis pris idéologiques ou métaphysiques plaqués sur le réel. Contre la logique hypothético-déductive stricte, ces démarches permettent donc de produire des énoncés théoriques « enracinés » (grounded theory) (Glaser et Strauss 2010 [1967]), c’est-à-dire ancrés dans la réalité empirique, que l’on se place dans un paradigme positiviste ou constructiviste.
Un second ensemble de règles de la méthode a trait à la contextualisation. Contextualiser les données consiste à rapporter les connaissances à leurs conditions sociales de production – le contexte n’étant jamais un simple arrière-fond mais toujours le produit d’une opération dépendante des interrogations des chercheur·e·s (Lahire 1996a ; Feuerhahn 2017). Comme le rappelle Christian Jouhaud, « le contexte n’existe pas préalablement à l’opération qui le construit […]. Il n’y a pas de contextes, mais des opérations, des procédures, des expériences de contextualisation qui touchent de manière partielle, spécifique et relative une part du réel historique » (1994 : 273-274). La contextualisation requiert de fournir des informations pertinentes sur des pans de réel à focale variable, dans toute leur profondeur historique et leur extension spatiale, pour comprendre l’objet étudié. Elle porte aussi sur la situation immédiate de la production de données sur le terrain – au sens de temps et lieu de l’enquête –, sur leurs producteurs et productrices, sur les enjeux locaux qu’ils peuvent soulever et sur leur intérêt pour la recherche menée. Il importe à cet égard de rendre compte des jeux d’échelles : les objets d’étude peuvent être abordés empiriquement et traités analytiquement à des échelles différentes, allant du microscopique des interactions observées au cadrage large de phénomènes abordés à l’échelle régionale, nationale ou globale en passant par l’étude de « cas » singuliers ou comparés (Burawoy 1998 ; Passeron et Revel 2005). Non seulement l’explicitation de l’échelle d’analyse permet de justifier le niveau et la portée de la validité des élaborations théoriques produites, mais le croisement des échelles ou la saisie multi-scalaire, en raison de l’interdépendance des échelles, peut aussi être une méthode permettant d’obtenir la vision la plus juste et complète d’un phénomène, comme l’ont bien montré l’histoire et la géographie tout particulièrement (Revel 1996 ; Brenner 2001 ; Planel et Jaglin 2014).
Enfin, un troisième principe de production de la connaissance « dans le vrai », qui recoupe par endroits la contextualisation, est la réflexivité comme « objectivation du sujet objectivant » (Bourdieu 2001, 2004). Loin d’être un narcissisme comme retour complaisant des chercheur·e·s sur leurs propres expériences, la réflexivité consiste à analyser la situation et le point de vue local et localisé de l’individu qui fait partie du monde qu’elle·il cherche à analyser autant que d’un champ académique qui la·le façonne. Cette posture a donné lieu à des tentatives variées allant de l’« ego-histoire » (Nora 1987) à l’« auto-(socio-)analyse » (Favret-Saada et Contreras 1981 ; Bourdieu 2004), en passant par des essais d’écriture dialogique (Rabinow 1977 ; Crapanzano 1980) et des publications de journaux de terrain3. Souvent revendiquée mais encore pratiquée de façon marginale – malgré des variations importantes selon les disciplines, l’anthropologie en ayant fait sa marque de fabrique depuis le tournant réflexif des années 1980 –, l’objectivation de soi doit permettre non simplement de se déprendre des postulats, préjugés et « prénotions » (Durkheim 2010 [1894]) mais aussi de travailler voire maîtriser le rapport subjectif à l’objet. Ce rapport subjectif, que la·le chercheur·e tend à importer dans son appréhension des réalités sociales en produisant toutes sortes de biais intellectualistes, ethnocentriques et genrés, est fonction de deux ensembles d’éléments. Il s’instaure tout d'abord sur la base de représentations du monde, de valeurs et d’attentes, qui sont le fruit d’attributs réels ou perçus de la·du chercheur·e, tels l’âge, le genre, la couleur de peau, les origines sociales et nationales, etc. (Bensa et Fassin 2008 ; Monjaret et Pugeault 2014). Il repose aussi sur la position et la trajectoire dans l’espace social de cette·ce dernier·ère, y compris dans le champ académique.
Or, malgré ces fondamentaux épistémologiques qui sont les conditions de possibilité de la véridicité des énoncés que les sciences humaines et sociales produisent, le constat se répète depuis plusieurs années d’une tendance des revues universitaires à valoriser la formalisation théorique au détriment de la mise à disposition des matériaux analysés. Ce « délestage empirique » (Olivier de Sardan 1996 : 16) est à l’origine d’effets de déréalisation, c’est-à-dire d’abstraction sans ancrage suffisant dans la réalité sociale et de simplification des complexités du réel. Bernard Lahire (2005, 1996b) parle de « surinterprétation incontrôlée » pour définir une « excroissance interprétative » eu égard au volume, à l’étendue et à la nature des matériaux empiriques. Jean-Pierre Olivier de Sardan (1996 : 1) évoque quant à lui la « maltraitance faite aux données » : « Le théoricien sollicite à l’excès les éléments empiriques ou produit des assertions qui n’en tiennent pas compte, voire les contredisent. » Ces « abus théoriques » (Quidu 2011) invalident les interprétations produites à l’intérieur d’une enquête, puisque celles-ci n’obéissent plus aux règles qui conditionnent la validité de leur énonciation. Mais l’enjeu de tels abus dépasse chaque enquête prise indépendamment. C’est tout le travail d’administration de la preuve, au fondement des sciences humaines et sociales, qui est miné par cette tendance au délestage empirique. Car « si est science ce qui admet l’exigence de la preuve, un système qui n’en appelle pour justifier des propositions qu’à un engagement ontologique en se soustrayant à la critique logique et à l’épreuve des faits ne peut être considéré comme telle », selon Jean-Michel Berthelot (1990). Le relâchement empirique soustrait les élaborations théoriques aux exigences d’être objectivement contrôlables, vérifiables voire réfutables par les pairs, et potentiellement par différentes catégories de public. Les articles de presse, journaux intimes, tracts, affiches, cartes, croquis, schémas, clips musicaux, photographies, récits de vie, entretiens, notes de recherche, et de manière générale tous les objets empiriques qui sont constitués en données pour la recherche, sont des signes qui « pointent vers une réalité extérieure » (Pomian 1999 : 33-34) à celle de l’élaboration théorique. Ils « certifient l’intention de l’auteur de laisser le lecteur quitter le texte » (Ibid.) pour se rendre compte par lui-même de l’adéquation entre le texte et la réalité extratextuelle qu’il prend pour objet. Ainsi, la mise à disposition insuffisante de ces éléments empiriques empêche que les énoncés sur les pratiques et les représentations sociales soient discutés, débattus mais également, si leur justesse est reconnue, appropriés au sein du champ et hors du champ en raison de leur force théorique ou de leur utilité sociale. Généralisé, le relâchement empirique pourrait graduellement induire un discrédit des sciences humaines et sociales et leur rabaissement à un discours parmi les discours.
De l’exigence éthique en général et dans les études africaines en particulier
L’exigence épistémologique posée au fondement de la rigueur empirique telle que Sources l’entend s’adosse à un impératif éthique qui structure les rapports entre le sujet connaissant et les sujets de la connaissance. Cet impératif impose la reconnaissance et le respect de l’humanité, de la dignité et de la réflexivité des individus qui informent, éclairent et guident la·le chercheur·e. Il se décline en différentes composantes ayant trait à la bonne conduite de l’enquête et au bon usage des résultats produits : nécessité d’un consentement libre, éclairé et continu des participant·e·s à l’enquête ; impératif de respect, de bienveillance voire d’empathie ; exigence de la confidentialité des données et de la vie privée ; devoir de restitution des données et analyses, etc. Ces principes ont été codifiés dans des textes de consignes ou d’énoncés de politiques éthiques, qui varient selon les pays et régions du monde, mais qui se rejoignent sur certains principes fondamentaux.4 Certes, les limites de ces déontologies désincarnées qui se multiplient et leur applicabilité en situation d’enquête ont été discutées (entre autres, Pels 1999 ; Fassin 2006 ; Bosk 2007 ; Benveniste et Selim 2014). Il n’en reste pas moins que c’est à condition qu’ils prennent appui sur des principes éthiques, à la fois à caractère universel mais aussi ajustés aux configurations singulières de l’enquête, que le regard distancé et l’approche critique nécessaires à l’objectivation du social sont empêchés de basculer dans la chosification des sujets de l’enquête, c’est-à-dire leur déshumanisation, porte ouverte à toutes sortes de mépris, d’abus et de violences.
Il importe d’autant plus d’insister sur les principes éthiques de la recherche que Sources a trait aux savoirs produits sur l’Afrique, définie ici comme le continent africain et ses extensions géographiques, politiques, économiques, socioculturelles et épistémiques passées et présentes, c’est-à-dire les Afriques atlantiques, les Afriques en diaspora, et plus généralement les Afriques dans le monde. Les pratiques de connaissance sur et à propos de l’Afrique initiées à partir de l’expansion impériale au xve siècle puis développées dans le contexte de la colonisation dès la fin du xixe siècle se sont élaborées sur la domination politique, économique, sociale, culturelle et épistémique des puissances européennes coloniales sur ce qui était alors l’Afrique, en particulier ce qui avait été découpé et catégorisé comme « l’Afrique noire ».
La science qui s’y est mise en place – nommée « africanisme » à partir des années 1930 – s’est adossée à une idéologie de la supériorité de l’Europe colonisatrice et de l’étrangeté radicale de l’Afrique (Sibeud et Piriou 1997 ; Sibeud 2002 ; Copans 2010). Identifier et nommer, classer et trier les êtres et les choses ont conduit, sous couvert d’une raison scientifique objective et impartiale, à réifier, inférioriser et exotiser l’Afrique, parfois dans le déni de la conquête coloniale mais souvent pour mieux servir celle-ci (Fanon 1952 ; Leclerc 1972). Les règles de la méthode sur la production et l’usage des matériaux ont non seulement été bafouées de manière répétée – aboutissant à des généralisations sans socle empirique ou, au contraire, appuyées sur un excès de certaines données au détriment d’autres données et du principe de recoupement –, mais le manquement aux principes éthiques dans la conduite de la recherche explique que les Africain·e·s ont couramment été traité·e·s non pas comme les sujets de la connaissance mais comme des choses à connaître, ainsi qu’à contrôler et à transformer. La médecine coloniale est un exemple particulièrement frappant de discours et de pratiques pseudo-scientifiques (Vaughan 1991). Des tendances à enchanter et idéaliser l’Afrique ont également travaillé l’africanisme chez les chercheur·e·s « fous d’Afrique » dont le rapport à l’Afrique s’est construit « sur le mode du passionnel, c’est-à-dire en dehors des formes du savoir intellectuel » (Ricard 2004 : 172).
La critique du champ du savoir occidental sur l’Afrique s’élabore dans les années 1960 et prend de l’ampleur dans les années 1970 à partir de la critique plus large de l’épistémè occidentale et de sa collaboration à l’impérialisme dans les espaces extra-européens (Césaire 1955 ; Saïd 1980 [1978] ; Mudimbe 1973, 1982, 1988 ; Miller 1985 ; Amin 1988). Elle a mis en lumière les impasses d’une « raison ethnologique » (Asad 1973 ; Amselle 1990) appuyée sur la logique du découpage, de la classification et de l’opposition. Certaines des critiques les plus radicales d’un africanisme français placé sous les auspices du « patriotisme scientifique » (de l’Estoile 1997 : 28) et institutionnalisé dans des disciplines, des départements, des séminaires et des revues, ont appelé à la dissolution des sciences humaines et sociales. Ainsi, pour V. Y. Mudimbe, « il n’y a pas d’innocence qui tienne lorsqu’on pratique les sciences sociales », qui ont été mises « au service d’un pouvoir de classe » ; c’est pourquoi il faut « défaire ces sciences du tout au tout » (1982 : 57). Face à cette position sans concession, c’est la tendance autocritique et réflexive qui l’emporte depuis l’intérieur de ces sciences appliquées à l’Afrique, devenues « études africaines », dans le but d’opérer leur renouveau. Il s’est agi de déconstruire l’exotisme académique et d’étudier les sociétés d’Afrique comme les autres (Bayart 1989), d’appliquer les mêmes exigences épistémologiques, méthodologiques et éthiques à ce champ de la connaissance qu’à tout autre et de lutter contre « la répartition inégalitaire de la légitimité scientifique à l’intérieur de la communauté internationale des spécialistes de l’Afrique » (Sibeud et Piriou 1997 : 15).
La nouvelle histoire coloniale attentive à l’incomplétude et aux incohérences du projet colonial et aux stratégies de résistance ou d’indifférence des colonisés (Cooper et Stoler 1997), l’histoire globale ou connectée qui désenclave l’Afrique en la branchant au reste du monde, et toutes les sciences humaines et sociales qui étudient leurs objets à la jonction du local et global et au prisme des circulations des idées, des objets et des hommes, par le passé et au présent, ont permis de déloger, au sein des études africaines, les stéréotypes d’une Afrique primitive, immobile, fermée sur elle-même et privée d’histoire. L’histoire des intermédiaires coloniaux et des pratiques de coproduction du savoir a permis de nuancer le face-à-face colonial (Tilley et Gordon 2007). Sans nier les positions asymétriques des parties prenantes, elle a montré le rôle essentiel des informateurs – ces « compagnons obscurs », essentiellement hommes, des premiers missionnaires, ethnologues et géographes (Simpson 1975) –, mais aussi des aides et des assistants éduqués (Schumaker 2001 ; Harries 2007 ; Carré 2015 ; Labrune-Badiane et Smith 2018). Ces intermédiaires culturels sont souvent anonymes mais leur identité « transparaît parfois – généralement en bas de page, en tant qu’élève, griot, garde, cuisinier, forgeron, etc. » (Dulucq 2009 : 16). Il faut compter également les écrits vernaculaires, ordinaires ou savants, traditionnels, institutionnels ou personnels, autonomes ou produits sur demande qui témoignent pour beaucoup de l’invention, de la réappropriation ou de la subversion des techniques, des procédures de connaissance et des savoirs (Peterson, 2004, 2012 ; Dulucq et Zytnicki 2006). Ils donnent à voir des « écritures africaines de soi » qui sont simultanément des modes de subjectivation en réélaboration (Boulaga 1977 ; Mbembe 2000). Le fait que les études sur l’Afrique, comme réalité et comme idée, ont conçu des concepts, des démarches et des perspectives inédites (Bates, Mudimbe et O’Barr 1993 ; Abdelmadjid 2018) montre enfin qu’elles ont été et sont toujours fécondes pour la théorie du social en général.
Toutefois, les appels actuels à « décoloniser » ou à « décentrer » la production du savoir sur l’Afrique et à renverser les asymétries épistémiques et institutionnelles rappellent qu’en 2020, soit près de cinquante ans après le constat des errements de l’africanisme, certaines doxas théoriques, clôtures académiques et routines institutionnelles restent d’actualité (Hountondji 2002 ; Quashie 2018 ; Doquet et Broqua 2019). La critique de l’universalisme européen interroge la capacité des sciences à énoncer l’universel sans tomber dans les particularismes ethnocentriques (Sibeud 2011 ; Amselle et Diagne 2018). Ces controverses ont été vives dans le champ anglophone en lien avec le courant des Subaltern Studies (Guha 1982 ; Spivak 1988 ; Chakrabarty 2000) et sous pression des mouvements sociaux et des mobilisations au sein des universités américaines, britanniques et sud-africaines (Ampofo 2016 ; Mbembe 2016 ; Matthews 2018). Elles ont également été amorcées dans les études africaines francophones autour du constat qu’il existe un abîme à combler entre les lieux où se fait l’histoire de ces Afriques dans le monde et ceux où elle s’étudie, qu’elle soit passée ou en train de se faire (Mbembe et Sarr 2017 ; Copans 2019a, 2019b ; Gueye et al. 2019).
Si ces débats témoignent davantage de questions et de divergences qu’ils n’établissent de constats partagés, ils engagent les études africaines dans un processus de transformation au sein duquel Sources prend place. Pour être efficace, tant la tâche est grande et la fondation d’une revue un défi (Blondiaux et al. 2012 ; Damerdji et al. 2018), sa contribution est circonscrite à un domaine d’action délimité : replacer la rigueur empirique au cœur de la production d’un savoir objectif, critique et réflexif ; promouvoir la diffusion des connaissances en accès ouvert pour le plus grand nombre en vue de contribuer à l’universalisation de la recherche ; encourager la publication de toutes celles et ceux travaillant sur l’Afrique et en Afrique, dans la définition extensive de ce concept ; constituer et conserver des corpus de matériaux de terrain créés et mis en accès libre qui puissent non seulement être consultables par des publics variés, au Nord et au Sud, mais aussi devenir des sources pour la recherche de demain, documentant tout autant les réalités africaines que ce qu’aura été la recherche sur l’Afrique, dans toute sa variété. Pour une revue dont la création s’est adossée à des personnels et des institutions de la recherche française, il reste encore, pour qu’elle s’accomplisse, à incarner dans ses instances et ses représentant·e·s, dans ses orientations et ses thèmes, dans ses numéros et ses auteur·e·s, une répartition juste des communautés scientifiques, afin de ne pas être une nouvelle ruse que l’Occident opposerait à l’Afrique dans l’objectif de maintenir sa mainmise épistémique, sous couvert non plus d’une raison classificatoire et hiérarchisante mais d’une raison empirique et archivistique.
Archivage et accessibilité des matériaux
Depuis une vingtaine d’années en effet, les projets de sauvegarde et de numérisation d’archives africaines se sont multipliés. Principalement portées par des institutions américaines et britanniques, ces initiatives entendent à la fois sauvegarder les matériaux (sonores, visuels, écrits) de la recherche et les rendre accessibles au plus grand nombre grâce à l’essor des technologies de l’information. Le projet « Matrix » de l’Université du Michigan (http://aodl.org/) ou le programme « Endangered Archives » de la British Library (https://eap.bl.uk/) ont largement contribué à l’essor du digital turn dans le champ des études africaines (Chamelot, Hiribarren et Rodet 2019). Nombre de matériaux sont désormais accessibles gratuitement sur ces plateformes, qu’il s’agisse des archives religieuses du Botswana, des archives coloniales locales du Burkina Faso ou de Guinée-Bissau, des archives privées d’Algérie, des dossiers judiciaires liés à la traite transatlantique des esclaves au Bénin, des archives de monastères éthiopiens, des enregistrements des orchestres guinéens, des archives du chemin de fer kényan, des archives familiales du Lesotho, des photographies du Liberia et d’Afrique du Sud, des manuscrits arabes du Mali, des archives de presse nigérianes, des archives syndicales soudanaises, etc. La diversité des thématiques, des données, des espaces géographiques et des périodes historiques couvertes témoigne, d’une part, de la vivacité des investigations menées sur et depuis le continent africain. La mise en ligne de ces matériaux constitue, d’autre part, une ressource formidable pour la recherche et l’enseignement et participe ainsi de la diffusion des savoirs.
Le récit enthousiaste de la révolution numérique de l’archivage ne doit pas pour autant occulter les nombreux problèmes et conflits qu’elle engendre. Outre la question de la pérennité et de la fiabilité des données informatiques, ou encore celle des risques écologiques de la dématérialisation (Berthoud 2012), nombre de débats scientifiques ont mis à jour les enjeux politiques de l’archivage numérique. Loin de constituer une recette miracle en faveur de l’accès égalitaire à la production de connaissances, la « ruée virtuelle » cacherait un nouvel « impérialisme numérique » (Breckenridge 2014). Ces controverses ont pris une forme inédite dans les années 2000 en Afrique du Sud, pays précurseur dans la création d’archives numériques5 et où la décolonisation des savoirs constitue un enjeu politique et scientifique vivace. Au cœur du débat s’opposent deux conceptions : les archives sont-elles un instrument de bonne gouvernance et de transparence démocratique ou un instrument de domination raciale et culturelle ? À bien des égards, les acteurs investis dans ces projets semblent reproduire la division des rapports Nord-Sud, à laquelle se combine une inégalité d’accès aux savoirs et aux ressources du Web entre les pays, les régions, les individus (Crampton 2003). La polémique porte également sur la propriété intellectuelle des sources numériques et les risques d’expropriation des États africains, des collectifs organisés et des individus de leurs documents, d’autant plus quand il n’existe pas de cadre légal ou que l’application de celui-ci nécessite des ressources juridiques inégalement partagées. Ainsi, si l’archivage numérique suscite de nombreux espoirs scientifiques, pédagogiques et citoyens, tout dépend des usages politiques et économiques qui sont faits de ces données (D’Alessandro-Scarpari et al. 2008).
Nourrie par ces débats d’actualité auxquels elle souhaite contribuer, Sources n’entend cependant pas se substituer aux projets d’archivage publics et privés de grande ampleur. La revue s’inscrit davantage dans la perspective de l’archivage des données des chercheur·e·s et dans la démarche de la science ouverte6. Documenter, structurer et pérenniser les données de recherche, produites individuellement ou dans le cadre de grandes enquêtes (Laferté 2006), relèvent d’une exigence épistémologique et éthique autant qu’ils constituent un défi collectif à l’ère du numérique (Clavert et Muller 2017). Si plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières années, par l’entremise de sites personnels ou de carnets de recherche7, rares sont encore les revues de sciences sociales à avoir enclenché le tournant de la diffusion des corpus de recherche en accès ouvert8.
Avec Sources, les matériaux associés à chaque article seront déposés partiellement ou dans leur totalité, selon les cas, et décrits dans des plateformes numériques dédiées à l’archivage des données de la science, adaptées thématiquement, et répondant au mieux aux principes du FAIR data9. Les limites à la divulgation de ces données sont juridiques et éthiques : protection de la vie privée, protection des données personnelles, propriété intellectuelle notamment. Afin de respecter ces principes, les sources disponibles publiquement pourront être partiellement anonymisées. La responsabilité de l’utilisation et de la représentation des sources, notamment celles ayant un caractère politiquement sensible ou mettant en jeu la protection des personnes, sera discutée collégialement et avec l’auteur·e. La revue est essentiellement publiée en ligne, permettant de multiplier les formats de sources (vidéo, sons, réseaux sociaux) sans se soucier de leur volume. Une importance cruciale est apportée à la restitution précise des métadonnées, des conditions de collecte et de la localisation des matériaux. Si la dématérialisation des documents conduit à leur altération, si les données numériques sont suspectées n’avoir ni odeur, ni saveur, ni texture, les contributions publiées dans Sources accordent une place primordiale à la dimension sensible, matérielle, contextuelle des données qui y sont discutées. Comme le souligne l’historienne Arlette Farge (Farge 1997), la traque et le temps passé à tourner les pages de montagnes de papiers poussiéreux sont des éléments essentiels à l’imprégnation des chercheur·e·s dans le monde étudié, comme ils le sont pour l’archéologue face aux vestiges du passé qu’elle·il cherche à comprendre. Ce souci de l’expérience vécue et de l’interaction est partagé par les enquêtes sociologiques, anthropologiques, géographiques, sociolinguistiques, littéraires, etc., menées dans le temps présent du terrain. Dans le sillage du tournant archivistique entendu comme « le passage de l’archive-comme-source à l’archive-comme-sujet » (Stoler 2019 [2009] : 77), les articles publiés dans Sources entendent lever le voile sur la longue chaîne de production des données et leur mise en archive analogique comme numérique, en révélant leur imbrication dans des enjeux de pouvoir et de savoir.
La mise en ligne des matériaux telle qu’elle est opérée dans la revue n’est donc ni exhaustive, ni un retour insidieux à la fétichisation des documents, et encore moins une invitation à déserter le terrain pour l’ordinateur, au contraire. Elle est conçue comme une porte d’entrée dans les coulisses du travail de recherche, une confrontation et une mise en commun des matériaux recueillis. Répondant à la nécessaire exigence de la preuve, elle favorise également l’interdisciplinarité à partir du croisement de sources utilisées par des disciplines différentes et réunies autour d’un sujet commun dans des dossiers thématiques. Une rubrique spéciale intitulée « Dans l’atelier des archives numériques » est également destinée à faire connaître des projets de collecte, de conservation et d’archivage de matériaux, anciens ou récents, ainsi que des ouvrages spécialisés portant sur les sources en Afrique et dans ses diasporas. Il s’agit de rendre compte de la dynamique à l’œuvre dans les projets de numérisation de sources africaines et de restituer les débats ou questionnements éthiques, juridiques, politiques et archivistiques qui entourent la mise en partage des données scientifiques.
Généalogie de la revue
Sources a vu le jour en plusieurs étapes. La première s’est déroulée à l’Institut français de recherche en Afrique de Nairobi (IFRA-Nairobi) au Kenya. En 2014, Marie-Aude Fouéré, alors chercheuse pensionnaire, inaugurait une rubrique intitulée « Sources, archives et matériaux » dans la revue biannuelle de l’institut, Les Cahiers d’Afrique de l’Est. Dans la préface au numéro 48 de 2014, elle annonçait de façon concise l’orientation empirique de cette rubrique, qui allait publier des « fieldwork materials collected by researchers (such as transcribed and translated interviews, songs, etc.) and primary sources (written local histories, political manifestos, poetry, disquisitions of philosophy or theology, biographies and memoirs, diaries, letters, etc.) edited, annotated and introduced by short accounts about their value and interest for a larger audience of scholars » (Fouéré 2014). Dans le numéro 49 paru la même année, trois articles répondaient à l’appel lancé. Ils présentaient et analysaient des matériaux originaux issus d’enquêtes de terrain qui, pour les chercheur·e·s qui les avaient produits, avaient tenu une place de taille dans leurs élaborations théoriques. Un entretien formel avec une universitaire influente de l’université de Makerere en Ouganda (Olivier Provini), des récits oraux collectés dans des villages de Tanzanie (Jean-Luc Paul), un imprimé vernaculaire élaboré par des leaders locaux au Kenya (Chloé Josse-Durand) se voyaient placés au centre de la réflexion. Ils étaient retranscrits ou reproduits en totalité dans leur langue d’origine (avec leur traduction dans le cas de langues rares, comme le kiluguru de Tanzanie). Le travail de contextualisation de ces matériaux et l’explicitation de leur rôle dans l’enquête prenaient le pas sur la théorisation (Provini 2014 ; Paul 2014 ; Josse-Durand 2014).
Le premier objectif de cette rubrique n’était pas de défendre un empirisme sans concepts, mais au contraire, dans une veine constructiviste et réflexive, de donner à voir les lieux, moments, actrices et acteurs de la (co-)production du savoir que neutralisent le plus souvent les écritures universitaires conventionnelles. Un second objectif était de pallier le manque d’espace offert, dans les revues, aux matériaux issus de l’enquête, contraignant ainsi les chercheur·e·s à rogner sur leurs données empiriques. Un troisième et dernier objectif était de constituer peu à peu des archives de terrain pour l’IFRA de Nairobi, accumulation au fil des ans des matériaux collectés par les étudiant·e·s et chercheur·e·s passé·e·s par l’institut. Archives collectives et partagées, elles devaient pouvoir être utilisables par d’autres comme sources d’information, mais aussi comme objets de l’analyse des chercheur·e·s du futur observant rétrospectivement ce qu’avait été la recherche de leurs aîné·e·s, les questions que celles·ci·ceux se posaient, les manières qu’elle·il·s avaient d’y répondre, et les conditions sociales et politiques de leurs enquêtes. L’idée d’une telle rubrique était arrimée à la singularité d’un institut français de recherche à l’étranger en tant qu’il est un lieu de la recherche au plus près du terrain, ayant vocation à soutenir le travail empirique.
Le bilan de ces deux numéros fut en demi-teinte : les chercheur·e·s se montraient enthousiastes lorsque les objectifs de la rubrique leur étaient exposés, mais cette dernière peinait à attirer un mode d’écriture inhabituel, peu valorisant et peu valorisable au regard des normes de publications et aux espaces de parution légitimes. Certain·e·s chercheur·e·s semblaient également soucieux, pour différentes raisons, d’avoir à partager très largement leurs matériaux d’enquête. L’initiative ne fut pas poursuivie au-delà des numéros 49 et 50 car elle allait se transformer, moins dans son contenu que dans sa forme.
L’arrivée de Marie-Emmanuelle Pommerolle à la direction de l’IFRA-Nairobi, à partir de septembre 2014, et le départ de Marie-Aude Fouéré, marque une seconde étape. Fruit d’une passation entre les deux chercheuses et d’une nouvelle saisie du projet par la directrice, l’objectif devint double : transformer ce qui n’était encore qu’une rubrique en une revue, rassembler plusieurs instituts de recherche autour de cette revue plutôt que de la faire porter par une unique institution. Les autres instituts de recherche à l’étranger (UMIFRE) basés en Afrique au sud du Sahara furent alors sollicités par Marie-Emmanuelle Pommerolle. Il s’agissait de maintenir le lien initial entre l’ambition scientifique de centrage sur les matériaux et ces lieux singuliers de la production empirique que sont ces instituts, mais également de répondre aux incitations des institutions tutelles – le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – à rassembler autour d’un projet commun des instituts que les habitudes professionnelles avaient porté à fonctionner en autonomie, au-delà de collaborations ad hoc. Le Centre français des études éthiopiennes (CFEE) d’Addis-Abeba, l’antenne de Khartoum du Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ), l’Institut français d’Afrique du Sud (IFAS-Recherche) à Johannesburg, l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA-Nigeria) à Ibadan et la Section française de la direction des antiquités du Soudan (SFDAS) à Khartoum s’impliquent alors dans le projet.
Un premier comité de rédaction se met en place dans le but de donner naissance à la revue. Il inclut les directrices et directeurs de ces instituts, des chercheur·e·s fondateurs et des chercheur·e·s intéressé·e·s par ce projet. Des propositions de numéros spéciaux émergent en lien avec des programmes de recherche en cours dans les instituts, à propos des sources de la violence, de l’articulation des sources en histoire et en archéologie ou encore des déchets comme sources. Reste alors à assurer l’aspect éditorial et logistique d’une revue dont l’ambition est à la fois académique et technique. Dans le cadre contraint des recrutements au sein des laboratoires, et alors que les revues universitaires sont, en général, très peu dotées en personnel d’appui, la demande de recrutement portée auprès du CNRS d’un responsable éditorial « mutualisé » entre l’unité Les Afriques dans le monde (LAM) de Bordeaux et les UMIFRE d’Afrique au sud du Sahara est acceptée. Depuis septembre 2018, Bastien Miraucourt assure tant le suivi éditorial que l’archivage en ligne des matériaux discutés dans la revue. Cette collaboration, d’abord fonctionnelle, permet d’élargir l’assise institutionnelle de la revue mais aussi sa solidité scientifique, avec l’adoption d’un comité éditorial comme structure de gouvernance. Ce comité est appuyé, depuis février 2019, sur une équipe de rédaction avec deux rédactrices en chef, le chargé d’édition et des rédacteur·rices réunissant des directeur·rice·s et chercheur·e·s des UMIFRE en Afrique et de laboratoires français qui assurent les choix éditoriaux et les tâches de fonctionnement. Le comité de rédaction s’adosse aussi à un comité de lecture qui est composé de correspondant·e·s scientifiques français·es et internationaux·les. Ces dernier·ère·s sont invité·e·s à proposer des thématiques de dossiers, à contribuer aux rubriques et à participer à l’évaluation anonyme des articles. La revue accueille des varia et des dossiers thématiques, pour lesquels un appel à contributions est diffusé. Elle valorise la publication de formats de texte différents. Principalement trilingue (anglais-français-portugais), elle accueille d’autres langues de publication (arabe, wolof, kinyarwanda, swahili, etc.) au cas par cas, accompagnées d’une traduction. L’élargissement institutionnel et scientifique devra prochainement se renforcer par une ouverture à des universités et des centres de recherche implantés en Afrique, et à leurs chercheur·e·s, qui sont les premiers partenaires des UMIFRE.
Sources : numéro 1
Le premier numéro de Sources, qui regroupe des varia, souhaite montrer la diversité des matériaux de recherche employés dans le champ des études africaines et les usages contrastés des pratiques de terrain en fonction des objets étudiés et des disciplines. Pour ce faire, il réunit six articles d’histoire, de science politique, d’anthropologie et d’archéologie qui, à partir de matériaux sélectionnés, présentés et analysés, ont en commun l’explicitation des conditions de collecte et des méthodes d’enquête, mettant au jour les biais induits par les choix adoptés mais aussi la pluralité des interprétations possibles et des pistes de réflexion. La critique des données constitue bien le fil rouge de chacune de ces démarches scientifiques, qu’elles prennent comme objet les sources les plus matérielles, à l’exemple des briques étudiées par Gabrielle Choimet au Soudan, en passant par les documents écrits issus de la presse nigériane des années 1940-1950 (Sara Panata), d’une campagne électorale locale au Kenya en 2013 (Chloé Josse-Durand) et de l’administration mahadiste du xixe siècle (Anaël Poussier), jusqu’à des sources numériques en contexte mozambicain (Rozenn Nakanabo Diallo) et des matériaux musicaux concernant le Burundi (Ariel Fabrice Ntahomvukiye). Si chaque contribution met en lumière une source ou un corpus, les auteur·e·s ont le souci constant de contextualiser leur enquête au regard des travaux existants et de confronter ces données à d’autres matériaux disponibles. La part occupée par les sources écrites dans ce premier numéro témoigne, s’il en était encore besoin, de l’importance et de l’ancienneté de la culture écrite dans les sociétés africaines (Ficquet et Mbodj-Pouye 2009 ; Barber 2007). Mais l’accent est surtout mis ici sur des écrits habituellement délaissés, marginalisés, occultés dans la recherche, car difficile d’accès du fait de leur caractère privé (tels des échanges de courriels) ou de leur technicité, à l’instar des sources comptables en arabe. Ces cas illustrent toute l’importance de la mise en ligne des matériaux afin de les rendre accessibles tant ils permettent de renouveler, par exemple, les approches des pratiques administratives (Nakanabo Diallo ; Poussier) habituellement appréhendées au prisme des sources étatiques. L’appropriation de l’écrit par les individus est tout particulièrement mise en lumière par Sara Panata et Chloé Josse-Durand, l’une par l’étude d’un corpus de lettres envoyées à la presse nigériane par des lecteurs et des lectrices, la seconde par l’analyse d’un « Code de conduite » rédigé par des anciens cherchant à maintenir leur mainmise politique. Ces sources, qui relèvent d’écrits ordinaires (Fabre 1993, 1997), ont été produites dans des contextes politiques incertains et conflictuels (décolonisations, élections). Attentives aux mots comme à l’environnement socio-historique de production de ces textes, les autrices nous montrent combien, au-delà de leurs injonctions normatives, ces écrits sont travaillés en interne par les anxiétés et les imaginaires de leurs temps. Étonnamment, les sources orales (entretiens, traditions) revalorisées par l’histoire et qui constituent les ressources premières de nombreuses enquêtes, ne sont mobilisées ici que de façon secondaire, afin d’éclairer et de contextualiser la production empirique. Et dans le vaste champ de l’oralité, les chansons gospels de la guerre civile au Burundi, désormais montées sous forme de clips vidéo diffusés sur les réseaux sociaux, retranscrites ici du kirundi et traduites en français par le chercheur, témoignent de la porosité des supports (écrits, sonores, visuels) qui transcendent les frontières longtemps imaginées entre culture matérielle et immatérielle. La matérialité des données est au centre des contributions réunies, attentives à la fabrication et à la diffusion technologiques, aux circulations, aux poids, aux usages et aux réceptions de ces sources dans les sociétés africaines. Elle trouve un écho singulier dans l’approche ethnoarchéologique de Gabrielle Choimet qui décrypte, avec une grande finesse, les façons de dire et les façons de faire des briquetiers soudanais contemporains, afin d’éclairer les pratiques de l’époque antique.
Ce premier dossier se clôt sur la rubrique « Dans l’atelier des archives numériques » composée d’un entretien avec l’historien Vincent Hiribarren. Ce dernier y analyse les enjeux du double tournant archivistique et numérique en Afrique à l’aune d’une riche expérience de recherche et d’archivage sur l’empire du Bornou (dans le nord-ouest du Nigéria) mais aussi à Madagascar ou au Bénin, faisant ressortir avec justesse les vifs enjeux économiques, politiques et écologiques que la numérisation de masse des archives fait surgir.
En donnant ainsi à lire, à voir et à entendre leurs matériaux de recherche, les contributrices et contributeurs de Sources ont accepté de se plier à l’exigence de la preuve. Elles·ils ont aussi accepté avec générosité de partager leurs données et d’initier l’aventure de cette nouvelle revue, ce dont nous les remercions. Que les auteur·e·s de ce premier dossier soient de jeunes chercheur·e·s n’est certainement pas anodin : cela témoigne d’une transformation des pratiques professionnelles, volontiers plus collectives et collaboratives, et d’un goût affirmé pour le terrain dont Sources se veut le relais.