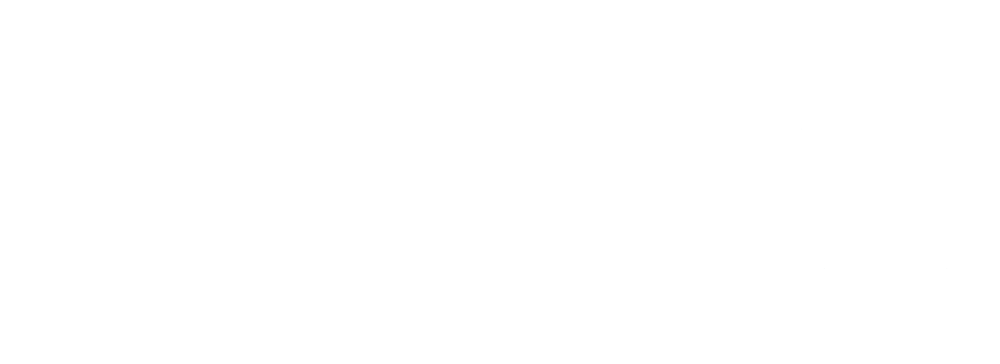Les coordinatrices du numéro souhaitent remercier vivement les relecteurs et relectrices anonymes qui ont grandement facilité le travail éditorial et amélioré la qualité des articles par leurs commentaires constructifs et leur bienveillance.
À l’heure où les crises écologiques s’aggravent et que la communication à leur propos s’amplifie et s’accélère à l’échelle mondiale, l’Afrique apparaît comme un continent particulièrement touché. En témoigne la multiplication, ces dernières années, de phénomènes hydro-climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, tempêtes) et de catastrophes écologiques (mégafeux), éprouvés à divers degrés par les habitant·e·s du continent au quotidien. Dans ce contexte, l’Afrique est un territoire qui suscite une production importante de savoirs naturalistes et environnementaux2, bien que ceux-ci circulent de manière inégale à l’échelle locale, régionale ou mondiale. Ces savoirs s’incarnent dans de nombreux objets et supports, allant de la carte ou du système d’information géographique (SIG) à la collection botanique, en passant par le recueil de connaissances et de classifications naturalistes dites « indigènes » (indigenous knowledge), de résultats chiffrés, parfois (carto)graphiés, sur la biodiversité et les ressources naturelles, ou encore de lois sur l’environnement et de prospectus de formats divers. Cette mise en forme et en valeur des savoirs et des données sur l’environnement va de pair avec l’expansion des activités extractivistes et d’exploitation des ressources sur le continent. Elle s’accompagne également de la multiplication des projets de protection des écosystèmes et de la biodiversité par les institutions, d’abord coloniales, puis nationales et internationales, ou plus récemment avec celle des programmes de développement sur la santé ou l’alimentation. Elle suit enfin l’urbanisation croissante et le développement touristique – considérés dans les sphères de la planification ou de la conservation comme des activités tantôt nuisant à l’environnement, tantôt favorisant sa protection –, ou encore le développement des innovations techniques dans la recherche et la communication environnementales.
Dans ce contexte, ce numéro place au centre de la réflexion les savoirs sur l’environnement et la nature en Afrique : qu’est ce qui est considéré comme relevant du savoir ou de l’ignorance autour des questions environnementales ? Comment, par qui et pour qui ces savoirs sont-ils produits ? À quoi servent-ils ? De quelle façon et par quels moyens circulent-ils ? Qui est considéré·e savant·e ? Et comment se construisent et se contestent les hiérarchies épistémologiques autour de l’environnement en Afrique ?
L’originalité du présent numéro réside dans l’appréhension des manières dont ces savoirs s’incarnent dans des supports et matériaux divers : carottes de sol, comptes rendus de réunions d’associations environnementalistes, textes législatifs, protocoles internationaux, prospectus touristiques ou brochures de communication pour des campagnes sanitaires sont autant d’exemples qui montrent comment les objets peuvent être des « lieux » de savoirs (Kaine 2002). Une fois collectés, classifiés et remis en contexte, ils deviennent des sources d’analyse au fondement des recherches en sciences sociales sur l’environnement en Afrique. L’intérêt de ces sources est qu’elles constituent des objets fondant et stabilisant des régimes de savoir, autrement mouvants et diffus. Par-là, elles permettent à la fois de tracer clairement la circulation et la confrontation des idées et des connaissances et de rendre saillants les rapports de force en jeu.
Les six articles et l’entretien présentés dans ce dossier mettent au centre de la réflexion une source ou un corpus de sources en lien avec la nature en Afrique, en s’attardant sur les gestes, les mots et le contexte matériel de « ceux qui savent », c’est-à-dire les expert·e·s et les scientifiques (Latour 1987, 32). C’est par le truchement de ces matériaux de recherche que différent·e·s contributeur·trice·s analysent la construction et la circulation des savoirs sur l’environnement, mais aussi les régimes de vérité, de scientificité ou d’ignorance qui hiérarchisent de tels savoirs. Pour ce faire, ils et elles mobilisent leurs sources comme des objets qui incarnent des intérêts économiques, des rapports de pouvoir ou des imaginaires de l’altérité propres au continent africain et à son histoire.
***
En nous focalisant ici sur la fabrique des savoirs, nous voudrions amorcer cette introduction par un bref retour sur le processus de construction de ce numéro. Cet exercice nous permet de revenir sur les processus de transnationalisation des savoirs sur l’environnement en Afrique et sur les inégalités affectant leur production. Nous présenterons ensuite quatre thématiques qui sont communes aux six articles et à l’entretien composant ce numéro. D’abord, nous soulignerons la façon dont les processus de conceptualisation de l’environnement créent des espaces d’interaction particuliers. Puis il s’agira de montrer que ces savoirs sur l’environnement et les objets dans lesquels ils s’incarnent sont le résultat de processus d’objectivation qui comportent aussi des dimensions affectives, esthétiques, sensibles et identitaires. Nous terminerons par une réflexion sur les processus de production des savoirs sur la nature en Afrique par les sciences sociales.
Transnationalisation et inégalités dans la production des savoirs sur l’environnement en Afrique
L’appel à contributions pour ce numéro, lancé fin 2019, a connu un vif succès, avec la réception de vingt-sept propositions d’articles. La plupart d’entre elles venaient de jeunes chercheur·e·s de diverses disciplines, nationalités et lieux d’exercice. Une part importante de ces propositions était constituée de textes collectifs qui émanaient de projets interdisciplinaires. Ils portaient sur des thématiques très variées allant des désastres écologiques ou de l’écotourisme à la gestion des ressources sylvicoles, en passant par l’étude d’objets muséaux comme vecteurs de savoirs sur la nature ou encore par celle de la gestion des déchets ou des ressources en eau. Le nombre important de réponses à cet appel témoigne ainsi de la centralité de la question environnementale dans les sciences humaines et sociales en Afrique, mais aussi et surtout de la nécessité d’une réflexion de la part des chercheur·e·s sur la dimension sociale et politique des modes de production des savoirs sur la nature sur ce continent.
Certes, les réponses à l’appel à contributions de ce numéro ne sont pas représentatives de l’ensemble des recherches en sciences sociales sur l’environnement en Afrique, mais elles permettent d’entériner ou de nuancer certains constats et de soulever quelques questions.
On peut d’abord souligner que la plupart de ces propositions étaient articulées à des projets internationaux de développement ou de gestion des urgences et des crises. Certaines portaient aussi sur des analyses historiques de la gestion de l’environnement par les institutions coloniales. La grande place que prennent les projets internationaux en lien avec l’environnement africain dans les thématiques de recherche en sciences sociales est à mettre en lien avec des changements de paradigmes théoriques et méthodologiques en sciences de l’environnement. En effet, les protocoles de description et les pratiques de catalogage par individu ou par espèce ont fait place au comptage de masse (Charvolin 2004), en orientant progressivement l’analyse vers la compréhension de phénomènes plus systémiques. En termes d’imagerie, on passe par exemple des planches et gravures décrivant des individus représentatifs de chaque espèce aux modèles de distribution des populations ou à des scénarios prédictifs de leur évolution (Gaudreau et al. 2015 ; Chansigaud 2007). C’est ainsi qu’à partir des années 1970, des organisations internationales telles que l’Union internationale pour la protection de la nature (devenue UICN, Union internationale pour la conservation de la nature), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ou le Fonds mondial pour la nature (WWF, World Wide Fund for Nature, ex-World Wildlife Fund) visent une compréhension de plus en plus globale de l’environnement et des espèces en tenant compte des stocks (gestion des populations et étude de leur démographie) et des dynamiques de migration. La transformation de ces méthodes et protocoles de recherche indique le glissement d’une approche protectionniste de la nature vers une approche gestionnaire et globale (Pinton 2014), qui requiert la construction de savoirs transnationaux et communs. Or, ces avancées techniques ne sont pas homogènes sur le continent africain et instaurent ou renforcent des rapports de pouvoir entre les régimes de savoir en jeu.
Ainsi, l’intérêt pour les situations d’internationalisation des recherches et des modes de gestion de la nature par les sciences sociales suit l’internationalisation générale des activités scientifiques qui, sans être exclusive au continent africain, le touche fortement et tend à renforcer les inégalités et les hiérarchies épistémologiques intercontinentales. Par ricochet, cet intérêt tient aussi à l’économie actuelle de la recherche en sciences sociales, qui suit en partie l’agenda des institutions internationales de gestion des crises, de conservation de la nature et de développement durable.
Or, ce constat pose la question des limites de cette internationalisation : existe-t-il en Afrique des espaces de production et de circulation des savoirs environnementaux qui ne soient pas traversés par des dynamiques d’internationalisation ? Si la question est rhétorique et la réponse évidemment affirmative, il en reste que de nombreux chantiers de recherche sont encore à entreprendre pour mieux comprendre les modes et les lieux de production des savoirs sur la nature en Afrique par les Africain·e·s elle·ux-mêmes, et sans qu’ils soient nécessairement inscrits dans la confrontation avec des pratiques et des savoirs exogènes.
Outre la dimension internationale des projets que nombre de propositions reçues se proposaient de présenter, et parfois d’analyser, on peut aussi noter l’emphase quasi-systématique mise dans ces projets de recherche sur le « développement durable » ou la gestion, voire même la résolution, des urgences et des crises écologiques sur le continent. Si cette emphase a bien sûr à voir avec l’intensification et l’accélération des dégradations environnementales, notamment en Afrique, elle témoigne aussi d’une tendance ancienne et qui reste lourde dans les façons d’appréhender les rapports à la nature par les sciences humaines et sociales sur le continent africain. Fruit d’une tradition « développementiste » dont les jalons sont posés dès la période coloniale puis affirmés dans les contextes post-indépendance, dans le cadre de la coopération technique puis des grands programmes de développement financés par des agences internationales comme l’Agence française de développement (AFD), cette tendance oriente fortement la production de savoirs sur les rapports locaux à l’environnement vers la fourniture rapide de « recommandations » et de « solutions » aisément applicables (Jacob 2000). Cette injonction à « l’applicabilité », et aujourd’hui à la « durabilité »3 des recherches en sciences humaines et sociales sur la nature imprègne aussi fortement la formation des étudiant·e·s et jeunes chercheur·e·s dans ce domaine, notamment sur le continent africain. On peut dès lors s’interroger, comme l’ont fait d’autres avant nous (Olivier de Sardan 2021), sur les limites à la connaissance des représentations et des relations à la nature en Afrique posées par cette orientation « développementiste » et « durabiliste » de la recherche en sciences humaines et sociales, aussi bien en termes de problématiques choisies que de méthodologies d’enquête retenues et de résultats obtenus.
Les réponses à l’appel à contributions témoignent aussi du petit nombre de grands projets de recherche sur l’environnement en Afrique, en regard des autres continents, et de la faible production scientifique des chercheur·e·s du continent dans l’ensemble sur ce thème, en tout cas à partir d’une approche bibliométrique, si contestée soit-elle (Eckert et al. 2018). Les causes de cette situation sont multiples et de nature diverse et varient selon les régions, les pays, les villes, voire les institutions. Elles tiennent à la fois à des aspects institutionnels (robustesse et structuration de la communauté scientifique, crédibilité des institutions scientifiques), économiques (politiques étatiques de soutien à la recherche, captation de financements internationaux) et historiques (coopérations internationales), comme le rappellent Waast et Gaillard (2018). Mais cette situation tient aussi à la manière dont les savoirs scientifiques sont construits, validés et diffusés, et aux outils de mesure mobilisés dans leur production. La production scientifique du continent paraît en outre très segmentée, variant selon les disciplines : alors qu’elle est largement développée dans certains pays du continent, comme l’Afrique du Sud et l’Égypte ou les pays anglophones du golfe de Guinée (Eckert et al. 2018 ; Losego 2008 ; Waast et Gaillard 2018), d’autres pays sont quasi absents des statistiques évaluant la production scientifique mondiale. Par ailleurs, la collecte de données sur l’environnement pour nourrir les bases de données nationales, régionales ou mondiales reste difficile voire impossible dans nombre de régions d’Afrique. Il faut aussi noter que la cartographie de la bibliométrie sur le continent ne saurait entièrement se superposer à celle des économies nationales4, à celle des certains écosystèmes très monitorés du continent (les deltas du Sine-Saloum ou du Nil, le delta intérieur du fleuve Niger, les bassins des lacs Tchad et Fitri, les forêts tropicales du bassin du Congo, entre autres) ou encore à celle des projets environnementaux internationaux.
Les sources des savoirs environnementaux en Afrique : acteurs, normes et rapports de pouvoir
Les réflexions développées par les contributrices et contributeurs portent plus particulièrement sur le choix des sources et sur leur accès selon les sujets de recherche, l’élaboration de protocoles de collecte de données, la réification des savoirs dits « locaux », « indigènes » ou « non experts », l’instrumentalisation des questions environnementales, la géopolitique et la démocratisation des savoirs, ou encore la conceptualisation de l’environnement « made in Africa ». L’entretien s’intéresse quant à lui au dessin et à la photographie comme outils de recherche et aux manières de diffuser les connaissances produites par les sciences sociales.
Traitant de pays divers (Madagascar, Mozambique, Éthiopie, Kenya, Soudan, Guinée, Sierra Leone, Nigéria, Cameroun) à des époques différentes et dans des contextes variés, les articles et l’entretien abordent des thématiques communes qu’il convient ici de présenter : la dimension relationnelle de l’étude du vivant, les processus de normativisation des savoirs sur la nature, et les rapports de force inhérents à la production de connaissances par les sciences humaines et sociales sur l’environnement sur le continent africain.
Penser la nature, imaginer le vivant : la conceptualisation de l’environnement comme espace d’interaction
Penser l’environnement n’est pas seulement une question de discours, de pratiques et d’artefacts, mais aussi une affaire relationnelle. Les différents modes de conceptualisation de la nature qui ressortent des textes de ce numéro sont enchâssés dans des interactions personnelles ou institutionnelles qui se jouent à des échelles très différentes.
L’entretien d’abord, réalisé par Luisa Arango avec les anthropologues Céline Lesourd et Émilie Guitard et les artistes Nicolas Deleau, Delphine et Élodie Chevalme, montre que la mobilisation sur le terrain de médiums artistiques, comme le dessin ou la photographie, pour appréhender les rapports à la nature en Afrique, ne peut s’abstraire des façons dont sont perçues les collaborations arts/sciences dans la sphère académique. Le choix de co-produire le savoir avec des artistes ou le recours à des méthodes d’enquête « créatives » dans les enquêtes de terrain ne manque pas ainsi de soulever de nombreuses questions, en termes d’enjeux de carrière et de reconnaissance de la légitimité de ces écritures particulières de la recherche par les pairs et les institutions scientifiques.
Dans un autre registre, Manohisoa Rakotondrabe et Fabien Girard d’une part, Emmanuelle Roth et Nelly Leblond de l’autre, soulignent le rôle clé que continuent à avoir les expert·e·s africain·e·s intermédiaires dans les projets en lien avec l’environnement sur le continent. Les deux premiers textes reviennent ainsi sur la figure classique du « courtier en développement » décrite et analysée depuis les années 1990 (Long et Long 1992 ; Lewis et Mosse 2006) et les travaux pionniers de Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995). Le texte de Nelly Leblond présente au contraire une posture un peu moins étudiée : celle de l’enseignant·e-chercheur·e africain·e appartenant à une institution publique de recherche et contribuant à la formation d’étudiant·e·s africain·e·s et au transfert de modèles de savoir et de recherche sur l’environnement5. Michel, le jeune vétérinaire travaillant pour le projet PREDICT en Guinée, Enoch, professeur en pédologie à l’Université catholique du Mozambique, ou encore le facilitateur de Natural Justice, prestataire du projet Darwin à Madagascar, donnent à voir chacun à leur façon les interactions institutionnelles de plus en plus complexes, multi-situées et hiérarchiques dans lesquelles leur travail s’inscrit. En analysant des espaces relationnels et institutionnels, les trois articles mettent également en exergue des agencements entre les acteurs en jeu et des objets qui peuvent être qualifiés d’« objets-frontière » ou d’« objets-intermédiaires » (Vinck 2009 ; Star et Griesemer 1989). Protocoles bioculturels, brochures d’information ou carottes de sol possèdent cette « flexibilité interprétative » (interpretive flexibility) qui leur permet de devenir supports de traductions hétérogènes, dispositifs d’intégration des savoirs, ou médiateurs entre expert·e·s et non-expert·e·s (Trompette et Vinck 2009, 5).
Les auteur·e·s montrent ainsi comment les acteurs intermédiaires adaptent, traduisent et accommodent les savoirs, mais aussi les ignorances environnementales, à leurs contextes d’action, qu’il s’agisse d’éviter les conflits qui pourraient les impliquer directement (Roth), de produire des savoirs en accord avec leurs convictions profondes sur la place des populations locales et des ressources environnementales (Rakotondrabe et Girard), ou d’adapter des protocoles de collecte d’échantillonnage européens au contexte local (Leblond). C’est en montrant les potentialités et les limites de ces objets frontières dans la médiation que les auteur·e·s ratifient l’intérêt d’une analyse par les sources pour souligner les rapports que les acteurs en jeu entretiennent entre eux, avec ces artefacts du savoir et avec les environnements qui les entourent.
Toujours sur l’aspect relationnel, en lien avec le traitement de l’environnement en Afrique, les articles de Gaële Rouillé-Kielo et de Guillaume Blanc présentent également deux points communs, cette fois-ci dans un registre historique. D’une part, les archives qu’il et elle mobilisent pour l’analyse dévoilent les rapports « dans les coulisses » des programmes de gestion et de protection de la nature au Kenya et en Éthiopie. Ceux-ci, même s’ils ne sont pas directement en lien avec des questions environnementales, ont aussi un impact sur la manière de gérer et penser l’environnement : conflits autour du paiement des salaires, frictions entre expertise internationale et administrations locales à l’aube des indépendances, cooptation de cadres internationaux·les dans un cercle restreint de connaissances (Blanc), ou encore désaccords qui deviennent des affaires personnelles entre les exploitant·e·s agricoles et les associations de riverain·e·s du lac Naivasha au Kenya (Rouillé-Kielo), façonnent les actions des institutions et des personnes sur la nature.
D’autre part, les deux auteur·e·s mobilisent des archives produites au moment des indépendances en Afrique. Ce faisant, il et elle questionnent les relations institutionnelles et personnelles dans un contexte de délitement colonial. Leurs articles tracent la généalogie des institutions étudiées et suivent la filiation ou la rupture entre des manières différentes de penser et de traiter la nature africaine. Discours et pratiques conservationnistes, préservationnistes, déclinistes ou extractivistes s’affirment, s’entremêlent ou entrent en conflit pour donner des orientations particulières à la gestion des écosystèmes africains.
Par ce biais, les auteur·e·s montrent que, en ce qui concerne la gestion de la nature et du vivant en Afrique, les décolonisations n’entraînent pas nécessairement un changement drastique des rapports de pouvoir en place. Certes, les nouveaux administrateurs africains vont acter un bouleversement des hiérarchies autour, par exemple, des questions administratives sur la gestion des parcs nationaux (Blanc). Mais les façons d’appréhender et de comprendre les natures du continent ne semblent pas être remises en cause, tandis que la légitimité des savoirs sur l’environnement africain produit par les expert·e·s internationaux·ales ne paraît pas être contestée.
Certains textes du présent dossier questionnent eux aussi les processus de réification des « populations locales » ou des « communautés », souvent présentées par divers acteurs de l’étude et de la gestion de l’environnement (administrateurs, agents de la conservation, associations locales, mais aussi parfois chercheur·e·s) comme un bloc monolithique, avec des pratiques et des savoirs homogènes et figés dans le temps. Dans les recherches de Manohisoa Rakotondrabe et Fabien Girard, il apparaît ainsi que les savoirs et les pratiques de différentes fokontany (communes à Madagascar) sont présentés dans le Protocole bioculturel sous le label de « traditionnels », « anciens », « immémoriaux » ou même « ancestraux », et pensés comme étant toujours enracinés dans des systèmes de croyances immuables et fermés sur eux-mêmes. En effaçant les conflits économiques et politiques au sein des fokontany, mais aussi les désaccords sur la qualification des semences lors de l’écriture du Protocole bioculturel, ce document néglige la relationnalité conflictuelle propre à des collectifs et à des individus aux savoirs dynamiques et changeants.
De leurs côtés, Nelly Leblond, Guillaume Blanc et Corten Pérez-Houis montrent de manière fine comment des pratiques sur l’environnement, plus fantasmées qu’attestées – en l’occurrence la sous-utilisation des sols dans la région Nord du Mozambique, la déforestation des montagnes du Simien en Éthiopie et la pollution des sols et de l’air à Khartoum, respectivement – sont présentés comme soit résolument néfastes, soit absolument vertueuses en termes écologiques. Or, bien qu’opposées, ces deux manières de voir négligent un nombre important de rapports de force et d’inégalités dans la mobilisation des savoirs environnementaux entre individus, collectifs locaux, scientifiques nationaux·les et chercheur·e·s internationaux·les. En même temps, ils cachent l’instrumentalisation des différents savoirs à des fins économiques, notamment d’accaparement foncier (Leblond et Pérez-Houis) et de mainmise de l’État sur un territoire d’insurrection (Blanc).
Reste que l’analyse des relations inter et intra-communautés épistémiques par les sciences sociales n’est pas toujours aisée : leurs interactions présentielles peuvent être rares et les chercheur·e·s n’ont pas toujours accès aux différentes parties prenantes de ces échanges. Ainsi, alors qu’on pouvait penser que les écueils liés à la réification des « communautés » (soit locales, soit épistémiques, soit internationales) étaient dépassés dans les milieux académiques, un important travail de déconstruction des stéréotypes et d’information est encore à conduire avec assiduité. Ce travail importe, face au foisonnement des programmes internationaux de gestion de la biodiversité ou des politiques publiques de conservation qui s’appuient souvent sur le modèle classique du transfert des connaissances des « savoirs savants » (scientifiques, experts ou académiques) vers les « savoirs profanes » (pratiques ou populaires) (Steyart 2006). Comme le démontrent les articles de Roth, Pérez-Houis, Blanc, Rakotondrabe et Girard, c’est principalement dans le cadre des régulations environnementales ou sanitaires, censées induire des changements dans les pratiques locales, qu’émergent des notions telles que celles de savoirs environnementaux « autochtones » ou « indigènes ». Si ces notions ont pu jouer un rôle dans la reconnaissance et le respect de la diversité des savoirs (Baronnet et Melenotte 2020 ; Bellier 2013), elles contribuent pour autant à renforcer une « coupure épistémologique » qui opère une distinction, voire une hiérarchie, entre les savoirs scientifiques et les « autres savoirs », sans s’attarder sur les raisons matérielles et historiques de cette distinction (Latour 1987). Ces catégorisations ont fait l’objet de nombreux débats portant sur l’instrumentalisation simplificatrice des typologies vernaculaires (Roué 2012 ; Roy et al. 2000). Il convient ainsi de continuer, par la poursuite assidue des recherches de terrain en sciences sociales, à déconstruire les visions essentialistes des rapports des sociétés africaines à leur environnement, qu’elles soient exprimées sur un mode critique, comme ce fut le cas durant la période coloniale et encore aujourd’hui dans nombre de projets de conservation ou de développement durable imposés « d’en haut », ou au contraire sur un mode romantique, comme la solution parfaite à la crise des relations au vivant qui affecte les sociétés occidentales actuellement6.
Identités, matérialités et affects dans la normativisation des savoirs et des pratiques sur le vivant
Cinq des six articles de ce numéro mobilisent des textes à caractère normatif comme source principale d’analyse (Blanc, Girard et Rakotondrabe, Pérez-Houis, Rouillé-Kielo, Roth). Ceci rend compte des processus de normativisation des pratiques liées à l’environnement et aux ressources à l’œuvre depuis au moins les années 1960 en Afrique. Ces processus confrontent les chercheur·e·s à une demande accrue de codification des savoirs et connaissances locales, à une époque où ceux-ci acquièrent une nouvelle valeur sociale et économique (Moity-Maïzy 2011).
Dans ce contexte normatif, les lettres qui préconisent l’éviction des populations des parcs nationaux du Simien (Éthiopie), le Protocole bioculturel qui vise à encadrer la négociation des semences de la commune d’Analavory (Madagascar) avec de potentiels prospecteurs internationaux, les lois sur la production de briques à Khartoum, les plans d’éradication de l’hyacinthe d’eau au lac Naivasha (Kenya) ou encore le « bat book » définissant les bonnes pratiques en matière d’interactions avec les chauves-souris pour différents pays d’Afrique et d’Asie dans le cadre de la multiplication des zoonoses, agissent comme autant d’objets programmatiques et gestionnaires. Ils indiquent, dans un écosystème donné, les espèces animales et végétales à éradiquer ou à protéger, et plus largement les formes de traitement de la nature à valoriser ou à bannir.
Dans ces articles, l’analyse de ces sources textuelles et de leurs usages révèle des décalages entre les pratiques et savoirs complexes sur le terrain et ce que les textes mobilisés comme sources en donnent à voir : il est en effet difficile de fixer des savoirs et des pratiques mouvantes, souvent transmises oralement et rarement codifiées auparavant (Bannister 2009). Cependant, l’intérêt n’est pas tant de rendre visible ce décalage, déjà bien identifié dans la littérature (Mitchell 2002), que de montrer sa fécondité pour saisir les dynamiques à l’œuvre dans la communication scientifique et dans les processus de codification des savoirs environnementaux en Afrique. L’expression des distinctions sociales, mais aussi des identités et des altérités en lien avec les savoirs, la matérialité des écosystèmes et l’intervention des affects et du sensible sont autant d’éléments qui rentrent en compte dans ces processus. L’entretien réalisé avec Céline Lesourd, Nicolas Deleau, Émilie Guitard, Delphine et Élodie Chevalme revient plus particulièrement et de manière critique sur l’opposition entre une prétendue objectivité scientifique et une subjectivité artistique assumée, ou encore sur la place accordée au sensible et à l’affect dans les processus de recherche et dans la diffusion des résultats de celle-ci.
Les textes de Nelly Leblond et d’Emmanuelle Roth montrent quant à eux comment l’intervention de certains objets (carottes de sol, brochures d’information) actualise des distinctions sociales déjà saillantes entre paysans et élites urbaines éduquées au Mozambique et en Sierra Leone. Ces deux exemples confirment que l’engagement des acteurs dans des processus de conceptualisation de l’environnement participe à la construction des identités et des altérités, des oppositions et des alliances possibles (Callon 2006). Ainsi, dans les deux cas, adhérer ou identifier un individu à un régime de savoir donné, avec tous les marqueurs sociaux associés à ce régime (tels que rouler en 4 x 4 ou communiquer en anglais) revient à s’attacher ou à l’attacher à une communauté épistémique, si diffuse soit-elle. Ce faisant, les auteur·e·s ouvrent une réflexion sur les rapports de pouvoir entre des régimes de connaissance émanant de communautés de savoir appelées de plus en plus à collaborer en Afrique et à compter dans les réflexions globales sur la mitigation de la crise écologique en cours (Jankowski 2013 ; Gowing et al. 2004 ; Viard-Crétat 2016).
Manohisoa Rakotondrabe et Fabien Girard analysent pour leur part les différents scripts qui sous-tendent un Protocole bioculturel développé à Madagascar : choisie pour son accès facile et selon des objectifs de développement technique définis par le gouvernement malgache, la commune d’Analavory, actrice principale du projet, est en réalité pauvre en ressources phytogénétiques et ne pourra vraisemblablement pas participer au programme intercommunal d’échange de semences envisagé dans le plan initial. Ici, la matérialité des écosystèmes entrave les textes et le discours participatif mobilisés par les agences internationales, tout en rendant visibles les contradictions entre les acteurs en présence. Une tout autre sorte de limite matérielle est analysée par Nelly Leblond, lorsqu’elle décrit les contraintes rencontrées pour mener une analyse pédologique au Nord du Mozambique selon les normes acceptées par les institutions internationales. Instruments vétustes, difficultés de transport des échantillons mais aussi faiblesse des coopérations internationales, concurrence des institutions privées nationales dans la recherche scientifique et méfiance des agriculteurs et agricultrices locaux·les vis-à-vis de la recherche menée témoignent tous de l’économie politique au cœur de la recherche sur l’environnement en Afrique.
Les articles de ce numéro mettent aussi en lumière la place des affects et du sensible dans les processus de normativisation des savoirs sur la nature en Afrique. Emmanuelle Roth explique ainsi comment la campagne de sensibilisation qu’elle étudie se focalise fortement sur le dégoût des populations locales pour la consommation d’un animal considéré comme abject, la chauve-souris, en négligeant les nombreuses autres formes de contact avec l’animal et ses excrétions tout autant potentiellement dangereuses. Corten Pérez-Houis montre quant à lui comment les nuisances olfactives, parmi d’autres types de désagréments, servent d’argument pour invalider la production de briques de terre à Khartoum au profit de celles en ciment, sans qu’aucune étude convaincante n’ait démontré que la production des secondes soit moins polluante. De même, Gaële Rouillé-Kielo s’attache à décrire comment l’idée diffuse de ce à quoi doit ressembler le paysage « naturel » du lac Naivasha entre en conflit avec, voire exclut, des savoirs et des pratiques liés à la production des fleurs pour l’exportation par exemple. Enfin, Guillaume Blanc attire l’attention sur l’appel récurrent aux dimensions esthétiques du site du Parc national du Simien dans les brochures touristiques : la beauté, la magnificence et le caractère unique des paysages et des espèces sont largement mobilisés comme motivations et justifications à agir directement sur les écosystèmes et pour l’éviction des habitants du parc. Ainsi, les sources mobilisées par ces quatre auteur·e·s s’inscrivent dans le développement d’une normativisation généralisée et s’encastrent dans des formes directes ou indirectes d’éducation esthétique et sensible du regard (Blanc et Rouillé-Kielo), de l’odorat (Pérez-Houis) et du (dé)goût (Roth). Or, on le sait, ces processus sont le fruit de formes d’ingénierie sociale, souvent non institutionnalisées (Law et Lynch 1988 ; Sicard 1998) contribuant à déterminer des préconisations sur le traitement de l’environnement qui peuvent par ailleurs simplifier, invalider ou discréditer certains savoirs et pratiques.
À cet égard, l’entretien associant les anthropologues Céline Lesourd et Émilie Guitard, les artistes Nicolas Deleau et les Sœurs Chevalme met en lumière l’engouement actuel pour les collaborations entre art et science, en ce qu’elles facilitent notamment l’appréhension et la restitution des dimensions sensibles et affectives des rapports à la nature. Delphine et Élodie Chevalme et Émilie Guitard évoquent par exemple la capacité du dessin ou de la photographie à rendre compte du rôle du végétal dans les « atmosphères urbaines », ce que la description ethnographique à l’écrit ne parvient pas toujours à capter et à transmettre au·à la lecteur·ice. De même, Céline Lesourd et Nicolas Deleau ont profité de leur collaboration en Éthiopie pour démonter ensemble, dans le cadre d’une bande dessinée, les clichés sur les circuits globaux de commercialisation du khat.
Ces approches sémiologiques (perception) et phénoménologiques (expérience), touchant aux dimensions esthétiques et sensibles de certaines sources et procédés de recherche, nous informent ainsi sur la place des affects et des attachements que peuvent générer les questions environnementales, en l’occurrence en Afrique.
Les savoirs des sciences humaines et sociales sur l’environnement en Afrique
Certain·e·s auteur·e·s du présent numéro ont été confronté·e·s à des contraintes pour rendre publics leurs protocoles d’enquête (Leblond) ou les documents produits par des institutions nationales (Pérez-Houis) et internationales7 (Roth, Rakotondrabe) devenus ensuite sources de leurs recherches. Dans le premier cas, le procédé de carottage des sols était largement associé par les collectifs d’agriculteurs et agricultrices aux processus d’accaparement des terres au Nord du Mozambique, tandis que, dans le deuxième cas, les comptes rendus d’enquêtes de terrain sur les briqueteries par des agents du Haut Conseil pour l’Environnement au Soudan, étant potentiellement confidentiels, risquaient de compromettre les interlocuteurs sur le terrain. Enfin, dans le cas des documents produits par des institutions internationales, bien qu’ils soient accessibles par ailleurs au grand public, leur inclusion dans un texte scientifique, contestant potentiellement leurs modes de production et d’usage, risque d’abîmer les relations, parfois fragiles, construites par les chercheur·e·s avec les membres et/ou les bénéficiaires de ces institutions sur le terrain. Si les auteur·e·s n’abordent pas cette question de manière centrale dans leurs articles, ils et elles évoquent tou·te·s des controverses possibles ou actuelles, réelles ou appréhendées, avec des interlocuteurs et interlocutrices direct·e·s ou indirect·e·s au sein de leurs études. De telles controverses dans les recherches en sciences sociales sur les savoirs des expert·e·s ont été documentées et montrent par exemple comment des conflits sur les identités professionnelles peuvent rendre l’analyse des chercheur·e·s contestée, voire impossible (Mosse 2011, 19). Les raisons de ces controverses sont bien sûr multiples et propres à chaque recherche, à chaque institution et aux rapports que chaque chercheur·e établit sur le terrain. On peut néanmoins esquisser ici quelques pistes de réflexions à ce sujet.
En effet, les quatre recherches citées précédemment sont prises dans des « dilemmes méthodologiques », découlant de situations où les chercheur·e·s en sciences humaines et sociales tentent d’absorber d’autres régimes d’expertise dans leur propre domaine (Boyer 2008). Elles illustrent par là comment les sciences sociales qui s’intéressent à l’environnement en Afrique prétendent d’une certaine manière évaluer ou englober les autres savoirs (scientifiques, vernaculaires, institutionnels, etc.). En ce sens, ils sont souvent vus comme pouvant les concurrencer, les critiquer ou même les invalider. Or, moins d’attention a été portée aux chercheur·e·s en sciences sociales et humaines comme producteurs et productrices de savoirs sur l’environnement en Afrique, à leur rôle dans les mondes des savoirs experts (scientifiques ou des institutions internationales) qu’ils côtoient, aux relations qu’ils y tissent et aux effets de la proximité et de l’éloignement épistémologique avec eux. Proximité dans le sens où les sciences sociales, de même que les acteurs du développement, sont préoccupées par la catégorisation et l’ordre social (Green 2011) et parce qu’elles partagent avec les sciences de l’environnement le même souci de validation scientifique. Éloignement parce que les sciences sociales interrogent les catégories sociales et tentent de rendre leur sens explicite, tandis que les acteurs du développement visent à modifier l’ordre social (Green 2011).
Ce questionnement vient confirmer la dimension politique des savoirs environnementaux en Afrique et montre que ceux produits par les sciences sociales sont également pris dans des rapports de pouvoir. En effet, ces études ne se placent plus à l’extérieur des situations observées, mais en deviennent intégralement partie prenante pour entrer dans une « relation de juridiction épistémique » (Boyer 2008) avec d’autres expert·e·s qui entendent aussi produire des savoirs sur l’environnement sur le continent. Ceci nous invite non seulement à la contextualisation géographique et historique des références aux nature(s) que nous rencontrons sur nos terrains, mais aussi à une réflexion sur les trajectoires individuelles et les savoirs situés, permettant d’interroger notre positionnement épistémologique. En tant que chercheur·e·s, il paraît ainsi indispensable de tenir compte dans nos analyses de notre relation aux régimes de savoir mobilisés par nos interlocutrices et interlocuteurs (qu’il s’agisse d’agriculteur·trice·s, de membres des forces faisant respecter les lois environnementales, d’enseignant·e·s-chercheur·e·s ou encore d’agents de projets internationaux en lien avec l’environnement, et qu’ils soient africain·e·s ou originaires d’autres continents) et dans les institutions que nous étudions (Stehr 2000).
Se pose enfin la question, pour la recherche en sciences humaines et sociales, des modalités de la critique des formes de production de connaissances par les sciences environnementales en et sur l’Afrique. En effet, les discours catastrophistes, voire déclinistes, concernant le continent africain sont largement repris dans les sphères conservationnistes et les médias internationaux. Or ces discours, convoquant des images dramatiques de la dégradation des écosystèmes africains sur des décennies, ne s’avèrent pas toujours fondés au regard des transformations écologiques effectives du milieu, comme en témoignent les articles de Guillaume Blanc et Gaële Rouillé-Kielo : les populations de walia ibex du Parc national du Simien en Éthiopie ne font que croître, malgré les annonces régulières de leur diminution ; l’eutrophisation et l’assèchement du lac Naivasha au Kenya ne se sont pas produits dans les années 2000, comme prévu dans les textes depuis les années 1970. En outre, ces discours peuvent être instrumentalisés pour servir des intérêts économiques et politiques divers. Les projets de grands travaux hydrauliques, avec parfois des transferts d’eau sur de grandes distances pour mitiger le risque d’assèchement, sont un exemple de l’instrumentalisation des risques hydro-climatiques à des fins politiques et économiques (Blanchon et Maupin 2009 ; Magrin 2016). Les difficultés à faire appliquer les Accords de Paris dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques posent aussi la question d’un abandon des objectifs de mitigation de ces changements pour des injonctions à l’adaptation des populations, de leurs usages et de leurs relations à leur environnement. Dans ce contexte, les chercheur·e·s en sciences humaines et sociales se retrouvent dans la nécessité de développer des compétences de diplomatie épistémologique (Latour 2012 ; de Vienne et Nahum-Claudel 2020). Il leur revient alors de restituer la complexité des relations sociales et politiques à l’œuvre dans les situations étudiées, dans une démarche constructive qui puisse contribuer aux réflexions globales sur la mitigation des effets de la crise écologique en cours, notamment depuis le continent africain.