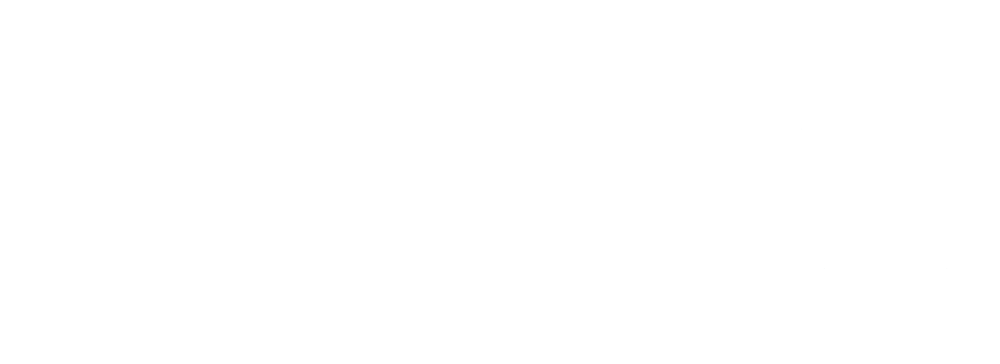Je ne saurais remercier assez les coordinatrices de ce dossier, ainsi que les collègues ayant évalué anonymement mon texte, pour les lectures aussi riches qu’insoupçonnées qui m’ont été conseillées et ont ouvert mes yeux sur le champ profus des études visuelles et de l’usage photographique en sciences humaines et sociales. J’espère avoir répondu au mieux à leurs suggestions, mais reste bien sûr seule responsable des probables imperfections qui subsistent dans cet article.
Données associées à cet article : « Réflexions sur les déboires d’une pratique photographique dans une recherche pluridisciplinaire au Burundi : images». https://doi.org/10.34847/nkl.7a62n78h.
24 photographies de différent∙e∙s auteur∙e∙s, prises dans le cadre de la JEAI Suburbu (« Subsistance urbaine et mobilisations du travail au Burundi (20e-21e siècles) »), également reproduites dans le cours de cet article.
Entre 2018 et 2021, j’ai participé à l’élaboration et à la réalisation d’un projet impliquant des enseignants-chercheurs et étudiants de l’Université du Burundi (UB), ainsi que deux chercheuses françaises résidant sur place, dont moi-même. Financé par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) dans le cadre d’un dispositif de « Jeune équipe associée à l’IRD » (JEAI), ce programme dit Suburbu, pour « Subsistance urbaine et mobilisations du travail au Burundi (20e-21e siècles) », a permis de mener de nombreux séminaires et missions de recherche dans le pays et à l’extérieur. Il s’est achevé en 2021 par un colloque à Bujumbura, et s’est prolongé en février-mars 2022 dans les locaux de l’Institut français du Burundi, avec une exposition photographique consacrée au travail en Afrique, sur laquelle je m’attarderai plus loin.
La JEAI Suburbu visait à éclairer des dynamiques urbaines peu investies par la recherche en sciences sociales consacrée au Burundi, pays encore très majoritairement rural et donc souvent étudié comme tel. Il s’agissait de mieux comprendre les nouvelles formes de l’ordre économique, social et politique qui fondent aujourd’hui la société urbaine burundaise en pleine expansion. Pour aborder cette question, notre équipe avait été pensée intergénérationnelle (nous avions entre 30 et 55 ans), pour que les plus expérimentés accompagnent les plus jeunes dans les enquêtes, et pluridisciplinaire, bien qu’elle ait été marquée par une forte composante historienne1. Elle était très masculine, mais hétéroclite du point de vue de nos parcours de vie et de formation respectifs. Nous souhaitions visiter la question des catégories, des représentations et des mobilisations du travail dans les villes burundaises, et pour ce faire quatre axes de recherche avaient été ouverts, deux concernant des secteurs d’emploi précis (employé∙e∙s de maison, taxis-vélos et motos) et deux autres des activités de définition plus lâche (travaux communautaires, agriculture urbaine). Nous fonctionnions en binômes (souvent un duo senior/junior), et sommes parti∙e∙s tou∙te∙s ensemble durant cinq jours dans cinq villes du pays, choisies pour leur diversité démographique, géographique, historique et politique : Bujumbura, Gitega, Ngozi, Rumonge et Rutana, en y retournant parfois de nouveau à un an d’intervalle.
Formatée pour satisfaire aux demandes des instances pourvoyeuses de fonds concernant la « valorisation sociétale », la « diffusion des connaissances » et la « vulgarisation », comme l’exprimait l’appel à projet lancé par l’IRD, la JEAI Suburbu prévoyait dans sa version liminaire la production de « visuels » destinés à nourrir une exposition photographique future. Dans la rédaction du projet soumis, tous les éléments de langage avaient été réunis pour renforcer cette intention : l’équipe s’engageait à des « prises de vues systématiques durant les enquêtes » et à la « restitution des résultats aux membres des communautés mobilisées » dans la recherche, notamment par l’organisation d’une « exposition à vocation large et publique », dans « des lieux ouverts et accessibles à tout public ». L’idée initiale était d’exposer les clichés sur les lieux d’activité ou de présence des travailleurs et travailleuses interrogés (kiosques de commerce à proximité des stations de taxis-motos et vélos, associations d’aide aux domestiques, murs d’espaces publics…). Nous avions aussi budgété l’achat d’appareils photo numériques compacts et le paiement de tirages grand format pour l’exposition prévue.
De fait, tous ces moyens ont bel et bien été alloués à l’équipe lorsqu’elle a remporté le financement de ses travaux auprès de l’IRD. Pourtant, rien ou presque de ce qui était prévu sur le papier n’a été accompli… En observant les clichés réalisés au cours de nos enquêtes à Bujumbura ou dans les autres villes du pays, le bilan est celui d’un relatif échec de notre approche photographique. Ni la quantité, ni la qualité ou même l’intérêt des clichés que nous avons pris n’ont vraiment répondu aux objectifs annoncés dans le projet. Certes, il arrive que les réalisations d’un programme soient revues à la baisse lors de son exécution, avec moins de publications ou d’activités que prévu, ou moins de séminaires ou rencontres qu’attendu. L’investissement plus ou moins important des membres d’une équipe et la durabilité de cet engagement en sont l’une des causes. Mais ici, c’est bien d’une quasi-absence de « bonnes photos » qui seraient utilisables pour une exposition ou utilisées dans la recherche dont il est question, c’est-à-dire d’une défaillance complète d’une partie de notre programme de recherche. Que s’est-il passé pour que nous ne parvenions pas à tenir nos objectifs initiaux ? Quelles sont les causes de cette déconvenue, et quelles leçons est-il possible d’en tirer ?
Cet article prend acte d’un revers pour interroger les impensés qui en sont à l’origine, et examiner les pesanteurs et les blocages intellectuels, culturels et humains qui ont verrouillé le champ des possibles photographiques dans le projet Suburbu. Il commente les quelques images qui ont été produites, mais aussi incite à considérer ces clichés qui n’ont pas été faits, ces photos que les membres de l’équipe n’ont pas voulues, pas pu ou pas osé prendre durant les enquêtes, et ces situations qui auraient pu « faire une bonne photo » pour une exposition ou la recherche, mais qui n’ont, finalement, pas été capturées. Il s’agit d’enrichir la réflexion de chercheur∙e∙s qui pourraient essuyer le même type de difficultés que celles rencontrées par l’équipe Suburbu et d’envisager la manière par laquelle un véritable tournant visuel pourrait s’imposer dans des projets ultérieurs en sciences humaines et sociales.
Mon propos s’organisera selon trois grandes lignes d’idées. Il sera d’abord question des attendus scientifiques du rapprochement entre sciences sociales et photographie dans le projet Suburbu, qui n’ont, en réalité, pas vraiment été réfléchis en amont. Puis j’isolerai certains obstacles et freins conjoncturels ou culturels qui ont manifestement grevé nos ambitions photographiques, en décrivant des clichés qui me paraissent éclairer le mieux nos travers et notre dilettantisme. Enfin, j’aborderai la question de nos (in)compétences techniques pour assurer des prises de vues correctes et employables à des fins heuristiques ou esthétiques. L’ensemble de ces réflexions m’appartient, c’est-à-dire que les développements comme les critiques qui en cousent la trame sont personnels et pas forcément partagés par les collègues qui ont participé avec moi au projet Suburbu2.
Méthode et pratiques visuelles : entre ignorance, négligence et impensés
Il faut le concéder : pas plus dans les prémices du projet Suburbu que dans sa mise en œuvre sur le terrain, les attendus de l’usage de la photographie par rapport à nos objets de recherche n’ont été clarifiés au préalable. C’est davantage pour répondre à une demande institutionnelle de production de supports de vulgarisation que pour infléchir nos méthodes d’enquête ou affiner nos analyses que nous avons imaginé avoir recours à la photographie. En fait, dans notre réponse à l’appel à projet de l’IRD, nous avons considéré la photographie uniquement pour ses fonctions illustratives et expressives. La possibilité qu’elle puisse être un instrument de recherche à part entière n’a pas même effleuré nos esprits, et aucun « tournant pictural » (Mitchell 1994) n’a été emprunté par l’équipe. Nous avons au contraire suivi un parcours banal, celui d’enquêtes qualitatives basées sur des sources écrites et l’identification des personnes intéressant nos binômes respectifs, interrogées dans des entretiens individuels ou collectifs consacrés à leur travail et à l’organisation de celui-ci. Ici et là des clichés ont été pris par les membres de l’équipe, mais rarement pensés dans la perspective d’une exposition et encore moins comme féconds pour l’avancement de nos connaissances. Nous les avons produits un peu au hasard, selon la présomption qu’ils composeraient au moins quelques souvenirs du terrain, et sans entrevoir qu’ils pourraient constituer des données d’enquête en tant que telles (Chauvin et Reix 2015, 16).
Comme une insouciance théorique
À côté d’un certain conservatisme à propos duquel j’exprimerai des critiques plus loin, la principale raison de cette absence de réflexion autour de nos usages de la photographie est simple, et d’un aveu embarrassant : en vérité, aucun membre de l’équipe n’était au fait de la littérature balisant le champ des études visuelles (visual studies) et des recherches sur ou avec l’image, pourtant abondante depuis quelques lustres (Becker 1981 ; Piette 1992 ; Maresca et Meyer 2013 ; 2016 ; Maurines 2015). Il faut dire que ces bibliothèques intellectuelles sont largement dominées par des travaux dans les domaines de l’anthropologie (Collier et Collier 1986 ; Schwartz 1989) et de la sociologie (Harper 2012 ; Chauvin et Reix 2015), qui n’étaient pas des disciplines représentées ou prépondérantes dans notre projet. Par ailleurs, bien que cela puisse étonner puisque la photographie porte en elle de consistantes traces historiques (Maresca 2000), « l’histoire par la photographie demeure infertile » (About et Chéroux 2002, 2), et les cinq historiens que nous étions n’ont pas échappé à cette impéritie que le géographe, le politiste et les deux sociologues de l’équipe n’ont pas mieux surmontée…
Cette méconnaissance des débats scientifiques portant sur la place de l’image ou de la photographie dans les sciences humaines et sociales n’est pas, semble-t-il, l’apanage de notre seule équipe. Les différents travaux menés depuis des décennies autour de l’image ne paraissent pas, en effet, être partout parvenus « à sédimenter des savoirs reconnus, légitimes et institutionnalisés dans la communauté scientifique » (Maurines 2015, 44), et cette absence de structuration disciplinaire, en France comme le dresse ce constat, ou au Burundi où nous avons effectué nos recherches, a peut-être nui à l’attention que nous aurions pu ou dû porter aux discussions scientifiques concernant l’image et ses usages. Dans les universités burundaises, ce qui a trait à ces questions relève des filières en communication et journalisme, et peu d’échanges existent entre chercheurs en sciences humaines et sociales et spécialistes de l’image3. Pour les premiers, l’image demeure « un outil de valorisation de diffusion de la recherche plus [qu’une] méthode particulière de recherche » (Maurines 2015, 54), et la proposition peut être retournée pour les seconds, qui souvent usent du discours académique comme d’un instrument de validation de leurs productions4. Cela étant, si ces éléments éclairent le contexte dans lequel l’équipe Suburbu a pu rester à distance des approches intellectuelles sur l’emploi des images dans la recherche, il est aussi vrai qu’une fâcheuse insouciance intellectuelle – d’aucuns y verraient de la négligence – l’en a tenue éloignée.
En ce qui me concerne, c’est en rédigeant cet article, et avant cela la communication dont il est issu5, que j’ai pu mesurer, a posteriori donc, les lacunes qui ont entravé notre approche photographique. Le constat est d’autant plus déroutant que j’ai moi-même suivi des formations en photographie argentique dont je n’ai pas songé à partager les enseignements avec l’équipe avant ou pendant notre terrain – j’en reparlerai plus loin. Cette prise de recul théorique, tardive et encore accentuée lors des révisions de ce texte, a fait éclore des regrets quant à la multiplicité des usages de la photographie à côté desquels nous sommes passés. Il en est ainsi de la méthode d’entretien par photo-stimulation (photo elicitation), qui vise à susciter les commentaires des personnes interrogées sur des supports visuels qui leur sont présentés, et dont les résultats sont d’une valeur heuristique notoire (Clark-Ibáñez 2004 ; Maurines et Sanhueza 2004 ; Papinot 2007 ; Bignante 2010). Nous n’étions pourtant parfois pas loin d’en saisir la richesse, lorsqu’il nous est arrivé par exemple, dans le binôme étudiant la domesticité, de montrer à des employés de maison des photos d’autres travailleurs de ménage interrogés, dans le but de les rassurer sur le fait qu’ils n’étaient pas les seuls à être photographiés dans l’enquête. Leurs réactions (« Je connais celui-ci, il vient de…, il travaille à… », « Je n’ai jamais entendu parler de cette association, sont-ils des travailleurs de ménage ? »6) auraient pu nous inciter à les faire s’exprimer davantage à partir de clichés, par exemple sur les réseaux ou les représentations liées aux domestiques. Mais faute de références méthodologiques, nous ne nous sommes pas emparés de cette opportunité de recueillir des paroles inédites. Pas plus n’avons-nous arpenté d’autres champs ouverts par les études visuelles, en matière d’approches sensibles ou de méthodes de travail, en utilisant par exemple la photographie comme prise de notes (Piette 1992). La somme des clichés que nous avons produits reste certes un matériau qu’il nous est toujours loisible, après-coup, de regarder comme « révélateur de terrain » (Cornu 2010). C’est d’ailleurs un peu ce que je propose dans ces confidences réflexives. Mais sur le moment cette intention n’y était pas, et même l’objectif d’une présentation dans une exposition a été égaré en chemin, entérinant l’idée que nos éléments de langage à ce propos étaient plus proches d’une astuce sémantique pour obtenir des financements que d’un véritable objectif de travail.
Une pratique photographique nonchalante
Avant la réflexion et les lectures qui ont nourri le présent texte, deux étapes de la réalisation du projet Suburbu avaient déjà été, pour moi, des moments clés de la découverte de nos déficiences en matière de photographie, à usage monstratif ou scientifique.
D’abord, pour constituer le rapport à mi-parcours dont j’assurai la rédaction en 2019, j’ai demandé aux membres de l’équipe de placer les photos réalisées depuis le début des enquêtes dans notre « drive » collectif. L’objectif était d’établir un bilan de notre production visuelle à un an du terme du programme et d’envisager la fameuse exposition « à vocation large et publique » qui devait se tenir en marge de notre colloque final. Le résultat de cette récolte fut décevant : certes, une centaine de clichés avaient été réunis par nos binômes, mais plus de la moitié consistait en des photographies de notre propre groupe de recherche, en pose (clichés 1 et 2) ou en situation d’enquête (clichés 3 à 5), et la plupart affichaient une définition à peine suffisante pour figurer en vignette sur internet (cliché 6). En tant que telles ces photos ne sont pas inutiles pour illustrer nos méthodes empiriques, mais elles ne sont que d’un maigre apport pour analyser les conditions du travail et de la subsistance en ville qui faisaient l’objet du projet Suburbu, j’y reviendrai. En outre, la collecte n’avait pas été méthodique, puisque des lieux et des moments d’enquêtes n’avaient pas été capturés tandis que d’autres l’avaient été beaucoup plus7, et pas toujours rigoureuse, puisque des noms de personnes photographiés et les lieux des prises de vues avaient été omis puis oubliés. De même, le défaut d’une sauvegarde systématique de nos photos au fur et à mesure des enquêtes sur un disque dur externe ou un serveur distant nous a coûté la perte de nombreux clichés pris par un membre de l’équipe qui s’est fait dérober son smartphone.
En fait, bien que nous ayons discuté du sujet « photographie » lors de nos réunions préparatoires, nous n’avions déterminé aucun protocole de production, de référencement et de conservation des images. L’exposition n’avait pas non plus été conceptualisée et nous n’avions pas fixé de consigne à propos des critères techniques exigés pour sa préparation, en particulier la nécessité d’une haute définition pour pouvoir tirer les clichés en grand format sans perdre en qualité. Malgré une discussion collective sur ces faiblesses intervenues après ce constat, peu d’améliorations ont ensuite été opérées, comme si d’obscurs blocages – à propos desquels j’ai quelques hypothèses – nous avaient empêchés d’amender la nonchalance de notre pratique photographique.
1. Réunion de l’équipe Suburbu à Gitega, quartier Nyabirahage, 2 avril 2018
De gauche à droite : Nicolas Hajayandi, Christine Deslaurier, René Manirakiza, Philbert Nkurunziza, Jean-Marie Nduwayo, Égide Nikiza, Alexandre Hatungimana.
Photographie : Anne-Claire Courtois.
2. Cliché posé de l’équipe Suburbu à Ngozi, devant le bureau provincial, 26 juillet 2018
De gauche à droite : Égide Nikiza, Philbert Nkurunziza, Alexandre Hatungimana, Jean-Marie Nduwayo, Christine Deslaurier, René Manirakiza, Nicolas Hajayandi.
Photographie : Désiré Manirakiza.
3. Entretien du binôme « Taxis-vélos et motos » : Nicolas Hajayandi avec le représentant de l'Association des motards du Burundi (Amotabu), Gitega, 5 avril 2018
Photographie : Anne-Claire Courtois.
4. Entretien du binôme « Domesticités » : Égide Nikiza avec la « nounou » (umuyaya) Espérance, quartier Muremera, Ngozi, 27 juillet 2018
Photographie : Christine Deslaurier.
5. Entretien du binôme « Domesticités » avec les membres du comité de l’association Twiteze imbere (« Ensemble pour le développement »), quartier Gabiro, Ngozi, 26 juillet 2018
De gauche à droite : Donatien Nkurunziza, Éric Sindayiragije, Égide Nikiza et Charité Nsengiyumva
Photographie : Christine Deslaurier.
6. Issa N., boy au quartier Muremera, Ngozi, 23 mai 2019
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 3309 x 1809 px).
Photographie : Égide Nikiza.
C’est ici qu’un autre moment de vérité est intervenu, lorsqu’il s’est agi de préparer l’exposition censée clore le programme Suburbu en 2020. Au-delà des difficultés liées à la pandémie de Covid-19 qui nous ont obligés à reporter le colloque final8, il est apparu que l’idée d’une exposition de rue à Bujumbura, dans un contexte administratif fermé, était utopique9. Aussi la perspective de lier cette intention au projet d’exposition et de journées d’études consacrées aux pratiques visuelles des photographes et chercheurs en sciences sociales que développaient alors Constance Perrin-Joly (sociologue) et Chloé Josse-Durand (politiste) est-elle apparue comme une très opportune alternative. Mais cette jonction a derechef mis en lumière l’indigence de nos connaissances en matière d’usages scientifiques du visuel, et surtout confirmé que la piètre qualité technique de nos clichés, en termes de résolution comme de cadrage, rendait impossible leur utilisation pour des tirages dans le cadre d’une exposition. Un heureux hasard a toutefois permis de sortir de cette impasse, lorsque j’ai découvert la production de deux jeunes photographes burundais, Keith Rodriguez Ntwari et Pacifique Bukuru, qui venaient de participer à une formation au storytelling photographique dans un espace associatif de Bujumbura10. Les deux récits visuels qu’ils présentaient, celui d’un vendeur ambulant de boulettes de viande cuite (clichés 7 et 8) et celui d’une jeune femme exploitée par sa sœur comme bonne à tout faire (clichés 9 et 10), faisaient sens et coïncidaient parfaitement avec ce que nous aurions pu ou dû réaliser dans le cadre du projet Suburbu. Ils avaient selon moi réussi à faire ces « bonnes » photos dont je m’étais souvent fait l’idée sur le terrain sans parvenir à la concrétiser, c’est-à-dire des clichés répondant non seulement aux contraintes techniques d’un futur agrandissement, mais encore rendant justice à l’activité de travail et au labeur quotidien des personnes exerçant de « petits métiers » en ville (Deslaurier 2021). Ce sont donc leurs clichés qui ont nourri la partie burundaise de l’exposition African Workplaces, présentée successivement à Addis Abeba, Bujumbura, Nairobi, Dar es Salaam, Arusha et en France entre 2021 et 2023, avec un succès mérité11. Ils ont également joué le jeu de la réflexion autour des liens entre chercheurs et photographes lors des journées d’étude de mai 2021, ce qui alimente pour partie les développements de la fin de cet article.
7. Jean-Marie, vendeur ambulant de boulettes de viande : la préparation à la maison, Bujumbura, 21 novembre 2019
Photographie : Keith Rodriguez Ntwari.
8. Jean-Marie, vendeur ambulant de boulettes de viande : la vente au quartier, Bujumbura, 21 novembre 2019
Photographie : Keith Rodriguez Ntwari.
9. Une vie de « yaya », ou le calvaire de Goreth : lessive et fatigue, Bujumbura, 21 novembre 2019
Photographie : Pacifique Bukuru.
10. Une vie de « yaya », ou le calvaire de Goreth : l’impossible repos, Bujumbura, 19 novembre 2019
Photographie : Pacifique Bukuru.
Obstacles, embarras et objections vis-à-vis de la photographie
Hormis la méconnaissance des travaux académiques portant sur la photographie en sciences sociales et son heuristique, à propos desquels l’honnêteté pousse à dire que nous avons été bien peu curieux, plusieurs freins ou obstacles peuvent expliquer les « ratés » de notre collectif en matière de prises de vues pendant les enquêtes. Ces blocages ont pu être circonstanciels, mais aussi des résistances, ou du moins des réticences bien ancrées peuvent être invoquées pour les expliquer.
Des difficultés circonstancielles et de l’autocensure
La conjoncture sécuritaire au Burundi est l’une des entraves à notre exercice de la photographie les plus évidentes à expliquer. À partir de mai 2015 en effet, le pays a sombré dans une profonde et violente crise politique liée à la décision contestée du président Pierre Nkurunziza de se représenter à un troisième mandat (qu’il a finalement obtenu). Des manifestations urbaines, une tentative de coup d’État manqué, des meurtres, des disparitions et l’exil de centaines de milliers de Burundais vers les pays voisins ont frappé cette année-là et les suivantes du sceau de la brutalité et de la répression extrêmes. En 2018, lorsque le projet Suburbu a débuté, la situation était encore loin d’être apaisée et c’est donc dans un contexte très tendu que nous avons mené nos enquêtes. La préparation même d’un projet de recherche associant universitaires burundais et françaises était une gageure à l’époque, alors que les autorités développaient un discours imputant aux intellectuels la responsabilité morale des débordements en cours et aux Blancs (ou aux « colons » : Abakoroni) un soutien politique et logistique aux dissidents. Nous ne l’ignorions pas, mais ne voulions pas nous résigner à languir dans le marasme qui plombait la société et ne plus rien projeter scientifiquement, d’autant plus que l’outil institutionnel et financier proposé par l’IRD (la JEAI) était à notre portée. Nous le savions même si bien que nous avons fait bouger les lignes de notre projet de sorte qu’il aborde des thématiques en apparence peu sensibles, susceptibles d’emporter l’adhésion de nos hiérarchies et d’être investies sans précautions excessives dans un climat politique contraint12. En outre, forts de notre affiliation à l’Université du Burundi et munis des ordres de mission officiels en émanant, nous étions confiants dans le fait que l’aura incontestable dont jouit encore la seule université publique nationale du pays, et donc ses membres (y compris les étrangères), nous préserverait d’ennuis administratifs ou policiers sur le terrain. C’était présomptueux : notre équipe a malgré tout fait l’objet d’une méfiance et d’une surveillance notable de la part des forces armées et des autorités politiques et administratives.
Ainsi, lors de notre toute première mission à Gitega13, le binôme travaillant sur les taxis-vélos et motos a été encerclé par la police dès ses premiers contacts avec les conducteurs de deux-roues, des armes pointées sur eux. Nous étions déjà tous éparpillés en ville et avons dû suspendre nos entretiens en cours pour partir à la rescousse de nos collègues (un Burundais et une Française), en nous en remettant aux responsables politiques provinciaux et communaux. Ces derniers ont en définitive interjeté en notre faveur après des heures d’attente et de discussions diplomatiques consacrées à nos positions et nos intentions : après quelques coups de téléphone, une signature et un tampon sur notre ordre de mission, le mot était passé aux effectifs de police, du renseignement et aux jeunes militants du parti au pouvoir (Imbonerakure) de nous laisser œuvrer. Mais le mal était fait : la situation de symbolique violente dans l’ambiance du moment nous a confinés ensuite dans une posture circonspecte dont nous ne nous sommes plus départis jusqu’au terme du projet. Nous avons abandonné l’idée de laisser à chaque binôme le choix de ses dates de mission pour ne plus voyager qu’en groupe complet (même si nos binômes s’autonomisaient une fois sur place) ; nous avons adapté nos agendas pour toujours garder libre une demi-journée de déférentes salutations aux autorités locales afin d’obtenir leur quitus et sa publicité auprès des hommes armés ; surtout, sans nous passer le mot, nous avons tous par la suite opté pour la discrétion et fait profil bas sur le terrain. Dégainer nos téléphones portables ou brandir les appareils photo que nous avions achetés pour « saisir » les individus au travail et dans les enquêtes est devenu sinon problématique, du moins secondaire. La photographie ne nous a pas paru être un moyen d’entrer favorablement en relation avec les enquêtés, comme certains chercheurs l’ont au contraire expérimentée (Cornu 2010).
Une forme d’(auto-)censure liée à la préservation de notre sécurité a donc indéniablement restreint notre pratique photographique pendant nos visites de recherche dans les villes du pays. Toutefois, cet empêchement volontaire croise d’autres motifs de retenue ou de résistance à la photographie qui ne relèvent pas de facteurs conjoncturels mais plutôt d’éléments plus structurels, ou culturels, qui composent un ensemble de points sur lesquels je voudrais m’arrêter un peu plus longuement.
Les usages de la photographie au Burundi et leur impact sur nos images
L’émergence de la photographie est récente au Burundi, bien plus qu’elle ne l’est ailleurs en Afrique, où le développement de studios et d’une communauté de photographes dès l’époque coloniale a été bien étudié par des anthropologues ou des historiens (Morton et Newbury 2015 ; Werner 2000, 2002 ; Nimis 2013 ; 2014). Pendant la colonisation, peu d’appareils étaient détenus par les « indigènes » burundais, et ce sont des photographes belges qui couvraient les événements ou les programmes publics importants, notamment dans le cadre du Bureau de l’Information du Congo belge et du Ruanda-Urundi (Schneider 2008). D’abord très centrée sur l’exotisme des populations locales (avec toutes sortes de portraits ethnographiques des « races » en présence, Hutu, Tutsi et Twa), la production photographique de cette agence coloniale s’est transformée dans l’après-Seconde Guerre mondiale. Plus événementielle et programmatique, elle s’est mise à rendre compte de manière solennelle des activités élitaires et des visites protocolaires, et de façon élogieuse des « œuvres » civilisatrices de la Belgique dans ses territoires africains. Lorsque le Burundi et le Rwanda ont recouvré leur indépendance, le 1er juillet 1962, ce service a été démantelé et l’Agence burundaise de presse (ABP) a été créée, au sein de laquelle a œuvré le plus célèbre photographe des années 1960-1980, Lazare Hagerimana, formé à la fin de la période coloniale. Quelques autres photographes ont émergé à la même époque, travaillant eux aussi pour l’ABP ou d’autres organismes officiels, comme Évariste Nkunzimana ou encore Pamphile Kasuku, dont les fils respectifs, Jooris Ndongozi Nkunzimana et Gustave Ntaraka, ont ensuite ouvert des studios ayant pignon sur rue au tournant des années 1990-2000. Toutefois les clichés réalisés par ces pionniers, pour la plupart conservés à l’ABP (Bujumbura), sont restés dans la continuité de ce qui se faisait auparavant, avec une forte attention portée à la vie publique des autorités et aux activités du gouvernement. La population n’était d’ordinaire photographiée que pour des démarches civiles ou administratives (photos d’identité, dossiers judiciaires, écrous pénitentiaires…), ou bien elle faisait de la figuration sur les photos des diverses célébrations nationales (messes, commémorations, meetings politiques…).
C’est à partir des années 2000-2010 que la photographie s’est répandue et généralisée dans le pays. À la faveur d’une effervescence médiatique née des programmes de réconciliation des années 1990 et de l’ouverture démocratique obtenue à l’issue de la guerre civile à partir de 2003, des journalistes ou des artistes visuels ont pu donner un nouveau souffle à la photographie (et à l’image animée, dont je ne parle qu’incidemment ici même si les photographes au Burundi sont aussi souvent cameramen ou vidéastes). Les productions de Papy Amani (« Papy Jamaïca »), Teddy Mazina, Jean-Pierre Aimé Harerimana (« JPA »), Arnaud Mugisha, Christian Mbanza, ou des deux jeunes photographes qui ont participé à l’exposition African Workplaces, Pacifique Bukuru et Keith Rodriguez Ntwari, témoignent par exemple d’une expression photographique dépassant le cadre de la mise en valeur des personnalités dirigeantes et des grands événements pour s’intéresser au quotidien, aux subalternes ou encore aux paysages. Par ailleurs, à côté de ces nouvelles dimensions professionnelles et artistiques, la photographie est aussi devenue un bien facile à produire, diffuser, montrer ou regarder. À mesure que se sont multipliés les possesseurs de smartphones, nombreux en ville et de plus en plus répandus à la campagne, les Burundais autrefois « sujets » photographiés ont pu (se) photographier librement et banaliser leur emploi de l’instantané. Cette popularisation n’a pas conduit au déclin des studios qui existent toujours pour assurer la production de photos d’identité (dites « photos-passeport ») ou les clichés et films des nombreuses cérémonies qui rythment la vie sociale burundaise (dots, mariages, remises de diplôme…). Mais elle a installé la pratique courante de la photographie et de la diffusion des clichés, partagés sur les réseaux sociaux ou montrés et commentés en groupe.
Dans la manière d’aborder les commodités fonctionnelles de leur smartphone, la plupart des utilisateurs burundais se limitent à un emploi familial ou amical de la photographie, ses aspects esthétiques ou informatifs n’étant pas la priorité des prises de vues. Les selfies ou les photos de famille ou de groupes d’amis souriants et heureux d’être ensemble sont privilégiés, et les clichés produits se réfèrent avant tout à la vie festive, aux loisirs et aux consommations collectives de leurs auteur.e.s. Cette façon d’appréhender l’image n’est pas critiquable – elle est d’ailleurs commune aux amateurs du monde entier –, mais elle induit certaines dispositions d’esprit qui ne sont pas toujours propices au développement d’une information photographique. Je m’y arrête un instant car c’est en conformité avec ces habitudes que les membres de l’équipe Suburbu ont réalisé leurs prises de vues.
La majorité des photographies que nous avons produites sont par exemple des clichés posés, rarement pris sur le vif, exactement comme lorsqu’une famille ou un groupe amical se figent et fixent l’objectif pour immortaliser un moment précieux (clichés 1 à 3, et 11). C’est en général à l’issue des entretiens, donc en marge de ceux-ci, que les personnes interviewées ont été questionnées sur la possibilité qu’un portrait d’elles soit réalisé et sur leur accord à ce que leur visage soit exposé dans une exposition, le cas échéant (clichés 12 à 14). Il fallait avoir gagné une certaine confiance au cours des entretiens pour s’autoriser une telle demande, d’autant plus que les difficultés sécuritaires du moment impliquaient une grande défiance à l’égard de tout ce qui pouvait laisser des traces et être utilisé pour une identification ultérieure, à quelque fin que ce soit. Mais il s’agissait aussi d’une exigence déontologique puisqu’il n’était pas question de « voler » des images en esquivant l’obtention de la permission des personnes photographiées, sauf à prendre des vues d’ensemble furtives et hasardeuses depuis une chambre d’hôtel (cliché 15) ou la rue (cliché 16). En définitive, nous avons pu collecter de la sorte une série de clichés qui ne sont pas sans intérêt dans la mesure où ils nous permettent d’individualiser nos souvenirs et de nous remémorer les noms, visages et propos des individus au moment de l’écriture scientifique. Ils constituent ainsi des données de l’enquête matérialisant la part sensible de nos recherches, celle de la rencontre avec les autres sur un terrain « qui résiste » (Labussière et Aldhuy 2012). Néanmoins ils n’ont pas une grande valeur ajoutée pour la connaissance de notre objet, car sans l’appoint d’un nécessaire commentaire descriptif (Piette 1992, 4), ils ne permettent pas de saisir l’activité des personnes photographiées et son contexte.
11. Binôme « Taxis-vélos et motos » : Nicolas Hajayandi et Anne-Claire Courtois avec un groupe de taxis-motos après un entretien collectif, Gitega, 3 avril 2018
Photographie : anonyme (un conducteur de moto depuis le smartphone de Nicolas Hajayandi).
12. Après l’entretien, Philbert N., domestique au quartier Rubuye, Ngozi, 28 juillet 2018
Photographie : Christine Deslaurier.
13. Après l’entretien, Charles N., magistrat traitant d’affaires impliquant des domestiques au Tribunal de grande instance de Gitega, 3 avril 2018
Photographie : Christine Deslaurier.
14. Après l’entretien, les taxis-vélos sur leur parking, quartier Yoba, Gitega, 20 novembre 2019
Photographie : Christine Deslaurier.
15. Vue de l’activité des taxis-motos et vélos depuis la terrasse d’un hôtel à Gitega, 2 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 1017 x 763 px).
Photographie : Christine Deslaurier.
16. Taxis-vélos photographiés en activité depuis la rue, devant le Parquet de Ngozi, 26 juillet 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (72 dpi, 2148 x 2860 px).
Photographie : Christine Deslaurier.
Une conséquence concrète de notre façon d’opérer « en amateurs » et en marge des entretiens est que les mouvements et la spontanéité sont absents de presque toutes nos photographies, à l’exception peut-être de celles concernant les travaux communautaires, qui impliquaient un grand nombre de personnes alignées dans des chaînes pour se passer les matériaux de construction (clichés 17 et 18). Ce sont en fait surtout des moments d’inactivité et d’immobilité que nous avons capturés. Or, même si l’on peut appréhender la pause, le répit ou l’attente comme parties intégrantes du temps de travail, le corpus final de nos clichés pourrait bien faire penser, à tort, que ces moments sont prépondérants dans les journées de labeur des travailleurs que nous avons rencontrés. Nos images statiques ont ainsi tendance à renforcer des stéréotypes sur l’oisiveté des travailleurs et travailleuses africain∙e∙s contre lesquels nous voulions au contraire nous positionner. Elles ne rendent guère justice aux heures de besogne harassantes que des domestiques, des taxis-vélos et motos ou encore des cultivateurs endurent chaque jour (clichés 19 à 21). Les mouvements et les gestes du travail que réalisent tous ceux et celles qui font des « petits métiers » en ville n’ont pas été photographiés parce que les entretiens venaient interrompre l’activité et qu’une certaine appréhension vis-à-vis de l’intrusion photographique nous a paralysés. Aussi, « ce qui aurait pu faire une bonne photo » pour notre exposition, à savoir le saisissement des gestes et le déplacement des corps dans les impulsions du labeur, a été manqué. La photo de faible résolution où l’on voit un boy de Ngozi, Issa, en train de faire la vaisselle, est une exception quelque peu arrangée (cliché 6). C’est bien dans cette position et à cette tâche que nous l’avons trouvé affairé lorsque nous sommes entrés dans la parcelle où il travaille, mais il s’était assis avec nous pendant l’entretien. C’est à l’issue de celui-ci que nous lui avons demandé de reprendre sa posture afin que nous puissions le photographier à l’ouvrage. Il s’agit donc d’un cliché composé, qui certes reproduit la réalité d’une scène habituelle, mais une scène rejouée.
17. Binôme « Travaux communautaires » : construction de l’École technique secondaire du quartier Kinyami II, Ngozi, 25 mai 2019
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 721 x 648 px).
Photographie : Philbert Nkurunziza.
18. Binôme « Travaux communautaires » : aménagements au stade Kugasaka pendant la « semaine de la diaspora », Ngozi, 26-27 juillet 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 1080 x 648 px).
Photographie : Jean-Marie Nduwayo.
19. Binôme « Domesticités » : Tharcisse et Clovis, « boys-cuisiniers » interrogés à Mushasha, Gitega, 4 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 607 x 1080 px).
Photographie : Égide Nikiza.
20. Binôme « Taxis-vélos et motos » : des conducteurs de vélos attendant des clients, Gitega, 3 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (72 dpi, 1305 x 1254 px).
Photographie : Nicolas Hajayandi.
21. Binôme « Agriculture urbaine » : la Sœur responsable des activités agricoles et horticoles au Centre Theresia de Mushasha, Gitega, 5 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 733 x 756 px).
Photographie : René Manirakiza.
Une autre complication a été celle de la monétarisation des prises de vues. Alors que le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde, lorsqu’un étranger à la famille ou à un groupe amical ou professionnel souhaite prendre une photo d’un individu ou d’un collectif, ou parfois même d’un simple paysage ou bâtiment, il n’est pas rare qu’une demande financière accompagne la prise de vue. C’est presque systématiquement le cas lorsqu’un ou une Européen∙ne tient l’appareil, mais les Burundais de l’équipe n’ont pas non plus été épargnés par ce type de sollicitation. Que de l’argent ait été donné ou non, la discussion engagée autour de cette question a régulièrement entraîné la retenue de la part des membres de l’équipe, gênés par la (non-)résolution de la requête14. Une manière de contourner l’obstacle a parfois été de nous prendre en photo avec les individus ou groupes rencontrés (clichés 3 à 5, 11 et 22), comme si cela pouvait tempérer le caractère « externe » et donc monnayable de la prise de vue. Une autre façon de faire a consisté à isoler sur la pellicule des sites sans présence humaine ou presque, ce qui a permis d’évacuer les questions de droits à l’image et d’économie monétaire. Des lieux du travail ou de réunions des travailleurs ont ainsi été photographiés, sans les travailleurs, comme cette façade du siège de l’Association des motards du Burundi (Amotabu) à Gitega (cliché 23) ou cette terre cultivée dans une parcelle privée de la même ville, où l’on voit un potager sans les habitants qui l’ont cultivé (cliché 24). Il y a bien des données exploitables dans ces clichés. Par exemple, on observe que la permanence de l’Amotabu (la plus puissante des fédérations de chauffeurs de motos) était fermée, comme elle l’a été à chaque passage du binôme travaillant sur les taxis-motos, ce qui questionne sur les modalités de rencontre entre responsables et membres de l’association. Ou encore, on peut distinguer dans la parcelle de la maison d’habitation (cliché 24) l’alternance de plantes d’agrément avec des choux et du maïs, ce qui informe sur les choix culturaux des citadins cultivateurs. Toutefois, l’absence des protagonistes laisse une impression de vide et de silence, alors que tout est habituellement agitation et bruit dans les activités de la route comme de l’agriculture.
22. Binôme « Taxis-vélos et motos » : Nicolas Hajayandi et Anne-Claire Courtois, entourés par des taxis-vélos après un entretien collectif, parking du quartier Yoba, Gitega, 3 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (72 dpi, 2734 x 1764 px).
Photographie : anonyme (un conducteur de vélo depuis le smartphone de Nicolas Hajayandi).
23. Binôme « Taxis-vélos et motos » : le siège de l'Association des motards du Burundi (Amotabu) à Gitega, 4 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (96 dpi, 625 x 852 px).
Photographie : Nicolas Hajayandi.
24. Binôme « Agriculture urbaine » : une maison d’habitation privée et sa parcelle de culture maraîchères, Gitega, 3 avril 2018
Photo prise au téléphone, fichier image original (72 dpi, 1982 x 1769 px).
Photographie : René Manirakiza.
Des réticences culturelles, intellectuelles et générationnelles
Des réserves plus générales que celles qui viennent d’être évoquées ont encore bridé l’enthousiasme photographique de l’équipe Suburbu et expliquent le peu d’attention que nous avons porté à la production d’images sur le terrain. Pour ce qui est de mon cas personnel par exemple, auquel j’adosserai celui de l’autre chercheuse française qui a participé à notre première mission collective, des considérations précautionneuses ont nettement inhibé mon engagement dans la prise de vue. En tant que femme blanche, en effet, d’office « située » dans l’altérité par mes interlocuteurs et d’autant plus repérable que tous mes collègues étaient des hommes burundais, je n’ai pas souhaité accentuer ma visibilité en prenant trop de photos. Mes propres préjugés à propos des clichés de type colonial et touristique, articulés à ceux des personnes rencontrées à propos des Bazungu (« les Blancs »), dans un contexte où la dénonciation des responsabilités des Occidentaux et autres « Abakoroni » dans la crise politique était ressassée par les autorités nationales, ont tout bonnement restreint mon « aire du photographiable » (Bourdieu 1965, 24). L’effet surplombant de mon appartenance au monde universitaire et de mon statut de personne éduquée, bien qu’involontaire, a encore moins contribué à l’élargir, car un certain trouble m’a saisie face aux personnes défavorisées et en majorité analphabètes que nous interrogions. La distinction entre illustration et voyeurisme photographique me semblait si ténue que j’ai répugné à braquer tout autre objectif que celui de mes questions sur le déclassement social de nos interlocuteurs.
Au-delà de ces questions d’assignation identitaire, il est également apparu au cours de nos discussions collectives que la démarche même de photographier les personnes avec lesquelles nous nous entretenions, ou des scènes de leur travail, n’allait pas de soi. Elle a fait l’objet de réticences de la part de certains collègues, mon impression étant que le plus âgé d’entre nous y était même franchement hostile. Il nous a interpellés en réunion sur l’ambition finale de la pratique photographique et de l’exposition envisagées, demandant si nous espérions devenir comme des peintres de musée et ajoutant, ironique, qu’il parlait bien d’un musée de « croûtes » et non du Louvre ou du musée d’Orsay… Sans doute révélatrice d’un manque de confiance en nos capacités à produire des clichés « artistiques » pour une exposition et d’un doute sur notre légitimité, en tant que scientifiques, à nous livrer à l’exercice photographique, cette assertion témoigne aussi d’une coupure générationnelle. Les usages photographiques ont en effet beaucoup évolué depuis une cinquantaine d’années, les appareils photo en argentique s’étant répandus au Burundi dans les années 1970-1980 de manière beaucoup plus limitée que les smartphones à partir des années 1990. Mon constat est que les étudiants membres de l’équipe Suburbu, âgés d’une trentaine d’années, qui ne sont pas nés avec un téléphone à captation numérique dans les mains, s’en sont malgré tout emparés plus tôt que les quinquagénaires de l’équipe (dont je fais partie), et l’ont utilisé de manière plus ordinaire au cours des enquêtes. En dehors du géographe parmi nous dont l’ancrage disciplinaire semble avoir influé de manière positive sur l’entrain photographique, peu de membres « seniors » de l’équipe ont en effet eu le réflexe de la photographie sur le terrain. La familiarité des plus jeunes avec leur smartphone a en revanche été plus propice à la production photographique, parfois compensée, cela dit, par une plus grande dextérité sociale des aînés.
De même, et ceci renvoie plutôt à une frilosité académique, la remarque de notre collègue peut être rapprochée de cette méfiance « devant l’image considérée comme trop proche de l’expérience esthétique et trop imprégnée de subjectivité » qu’Albert Piette a relevée ailleurs (1992, 1). Elle traduit également une préférence pour le texte. En effet, il n’y a pas qu’en Occident que la « tradition intellectuelle […] a toujours privilégié le document écrit » (ibid.). En Afrique aussi, et singulièrement au Burundi où l’oralité est pourtant fondatrice des relations sociales, la culture de l’écrit est choyée et survalorisée dans les sphères élitaires. C’est ce qui distingue les intellectuels et les lettrés burundais de leurs concitoyens en majorité analphabètes. Les universitaires et chercheurs accordent de la sorte une bien plus grande valeur à la production de textes publiés ou publiables qu’à celle de tout autre support de données. Si le travail de dentellerie de l’écriture scientifique est assumé et recommandé dans les sphères de l’enseignement supérieur et de la recherche, dès lors que quand on fabrique un texte, « on choisit […] d’adopter une mise en forme plus ou moins sophistiquée pour exprimer une idée » (Conord 2007, 14), les mêmes qualités ne sont pas reconnues au « discours iconographique » et à ses contraintes d’élaboration technique, stylistique et scientifique (matériel et filtres, couleur et luminosité, définition, choix du cadrage et du sujet, contenu informatif, etc.) (ibid.). Ciseler les mots avec subtilité et efficacité est plus noble que manier en dilettante des images à l’esthétique d’ailleurs indifférente aux uns ou rebutante aux autres.
Au-delà de la question de l’écrit et de ce que pourrait être une image textualisée ou une prose imagée, ces expressions de défiance ou d’hésitation face à l’usage de la photographie comme mode d’exposition des résultats du terrain ou d’analyse dans les sciences humaines et sociales, dans lesquelles je reconnais parfois mes propres scrupules, est en fait aussi le résultat d’un manque d’éducation à l’image. L’éducation étant comprise ici comme le comblement d’ignorances qui conduisent au rejet de méthodes d’investigation inventives ou originales, et l’image entendue dans une acceptation plus large que celle de la seule photographie, je suggère que son enrichissement passe par une collaboration accrue avec des photographes attitrés ou des spécialistes de l’image dans les projets de recherche (Maurines et Sanhueza 2004).
Des (in)compétences et des voies pour y remédier
Mon dernier point d’analyse a trait à nos insuffisances techniques et matérielles et aux connaissances que pourraient transmettre ceux qui maîtrisent mieux le domaine visuel pour les atténuer. Je m’arrêterai aussi sur les bénéfices – et les biais – qu’un autre regard et une émotion intellectuelle tierce pourraient apporter à des pratiques d’enquêtes collectives sur le terrain.
Têtes coupées et appareils pas si intelligents : nos faiblesses techniques
Parmi les membres de l’équipe, personne en dehors de moi n’a eu le privilège d’accéder à un appareil reflex argentique et à des formations à la photographie au cours de son parcours universitaire. À l’époque où le numérique n’existait pas encore et où je développai les négatifs dans ma salle de bains convertie en chambre noire, encouragée par les opportunités de stages qu’offraient alors les services publics français à la jeunesse, il y avait peu d’appareils photo disponibles au Burundi, et aucune formation dispensée dans le domaine. Ainsi la photographie en argentique était méconnue, et l’irruption ultérieure du smartphone dans la société ne s’est pas toujours accompagnée d’une transmission de ses exigences et de ses règles, mais plutôt a généré de nouveaux codes et canons techniques et esthétiques. Sans déprécier ces derniers qui ont leur propre logique et sont aussi mobilisables pour l’intérêt de la recherche, mais peut-être avec une pointe de conservatisme hérité de ma pratique en argentique, il me semble que cette évolution n’a pas joué en faveur de la qualité de nos clichés – du moins dans la perspective de les exposer. L’absence de maîtrise de certaines règles de base en matière de cadrage, de lumière, de définition ou de mouvement, explique ainsi que la plupart des photographies réalisées par l’équipe souffrent de défauts originels que même des opérations d’amélioration via des logiciels spécialisés comme Photoshop ne sauraient rattraper. Effet guillotine du visage coupé à ras du cou, ou des jambes, bras et troncs tranchés dans le vif, flous pas très artistiques, ambiance de nuit en plein jour ou soleil écrasant les visages, les imperfections sont à mes yeux patentes, dommageables, et sans rattrapage possible. De mon point de vue, ce ne sont pas de « bonnes » photos en termes techniques. Les outils disponibles aujourd’hui permettent certes de retravailler un cliché ou de lui appliquer des filtres, mais s’il est d’emblée mal construit, très pixellisé, sur ou sous-exposé, il a peu de chances de passer le cap de l’agrandissement pour une exposition, ou même de la publication dans un livre, une revue ou sur internet (cet article fait d’ailleurs exception en quelque sorte, puisque j’y présente des clichés pauvres en pixels).
Cette critique que je m’adresse aussi dans la mesure où mes acquis techniques n’ont pas vraiment profité à notre projet, puisque je ne les ai pas transmis ni même parfois appliqués, vaut aussi bien pour les photographies prises par ceux qui tenaient en main l’un des deux appareils numériques dont s’était dotée l’équipe15, que par ceux qui les ont capturées avec des smartphones. Cependant, j’ai remarqué que la résolution des images prises par les binômes travaillant sur les travaux communautaires et l’agriculture urbaine, qui utilisaient les appareils numériques à disposition, était en général supérieure à celle des clichés obtenus via un smartphone. Ajouté aux défaillances initiales sur les prérequis de la prise de vue, ce point illustre aussi des limitations d’usage induites par la qualité et la méconnaissance du matériel lui-même. D’une part, nos téléphones n’étaient pas tous du dernier cri, et d’autre part, le potentiel de réglages des smartphones est en fait souvent sous-utilisé, peut-être parce que leur maniement d’apparence commode donne l’illusion qu’ils sont plus « intelligents » que leur utilisateur, et conforte l’insouciance de celui-ci. Il est pourtant possible de fixer en amont de la prise de vue de nombreux et précieux paramètres, qu’on trouve justement prédéfinis dans les petits appareils numériques que nous avions achetés (stabilisateur, focale, détection automatique de la luminosité…), ce qui pourrait expliquer cette différence de qualité entre les clichés. Une formation à la photo sur smartphone, même élémentaire, aurait pu être envisagée pour pallier ces utilisations trop bornées de nos équipements numériques, mais nous ne l’avons pas anticipée.
Faudrait-il en réalité que chaque chercheur∙e suive des stages pour pouvoir utiliser la photographie, qu’elle soit prise comme vecteur d’une réalité « objectivée » pour jouer sur les mots, ou comme outil de connaissance ? La volonté ou les disponibilités d’agenda n’y seraient peut-être pas pour chacun∙e, et le coût financier excéderait les budgets qui sont habituellement alloués aux projets en sciences humaines et sociales. Une solution ne serait-elle pas alors que soit rattaché∙e un ou une photographe en titre aux projets et aux équipes qui adhèrent à l’idée que les images sont des données d’enquêtes pertinentes ? J’en suis partisane à l’issue du projet Suburbu et de ces pérégrinations réflexives.
L’utile et nécessaire collaboration avec les spécialistes de l’image
Que ce soit auprès de mes amis « touchant » à la photographie en France, en Belgique ou au Burundi16, ou au contact de professionnels de l’image, de journalistes visuels, de chercheurs-photographes ou de photographes-chercheurs, je n’ai cessé d’apprendre de ceux qui « portent leur regard » sur la société plutôt qu’ils ne « l’observent », comme nous en avons l’habitude dans le monde académique. Au vu de mes expériences récentes, il me semble que la plus-value d’une collaboration et d’un dialogue avec ceux dont le métier ou l’engagement sont tournés vers l’image est flagrante. Il existe des avantages en termes d’apprentissage sur les matériels, les techniques et les astuces de la prise de vue, et des vertus pratiques à l’embarquement d’un photographe dans un projet de recherche, venant croiser sa professionnalité avec celle des chercheurs (Maurines et Sanhueza 2004). Non seulement il dispose de compétences pour produire des images nombreuses et de meilleure qualité, et d’une capacité de transmission de ses savoirs, mais encore le fait qu’il ne se préoccupe que de cela autorise une forme de libération de la gaucherie et du temps des chercheurs. Photographier sur le terrain n’est pas neutre ni sans conséquence sur les modes de questionnement et la dynamique de la recherche, et entendre la parole des personnes interrogées tout en ayant à gérer un appareil photo que l’on maîtrise moins bien qu’un stylo est chose malaisée. Il faut surmonter les questions de technicité de l’acte photographique tout en neutralisant les difficultés que la visée dans un objectif peut produire alors qu’un dialogue avec les acteurs est en cours. Les interférences paraissent moins délicates à gérer lorsque les rôles sont dissociés et que chacun se concentre sur ce qu’il sait le mieux faire.
Tout cela a bien sûr un coût financier et une portée scientifique qu’il faut évaluer, puisque le photographe doit être membre à part entière de l’équipe17. Il y a lieu de budgétiser une présence et un suivi physiques des enquêtes, d’intégrer aux réflexions scientifiques de l’équipe une autre manière de penser, et réciproquement de parvenir à montrer au photographe le chemin et le sens des investigations en cours pour qu’une complémentarité s’installe. Mais cela est surmontable et les effets du croisement entre pratiques et méthodes photographiques et scientifiques sont bénéfiques, comme en attestent les textes de chercheurs et de photographes qui se répondent dans le catalogue de l’exposition African Workplaces déjà plusieurs fois évoquée.
En dernier ordre, il pourrait être répliqué à mes affirmations que certain∙e∙s chercheur∙e∙s parviennent très bien à faire seuls de « bonnes » photos tout en conduisant leurs enquêtes (Conord 2002 ; 2014 ; Perrin-Joly et Josse-Durand 2021), ou encore que la présence d’un tiers non engagé directement dans la conversation et la relation d’enquête peut y introduire un biais d’interaction. Je ne trancherai pas ici ces questions, qui ne me paraissent d’ailleurs pas antinomiques avec l’idée de modifier, quoi qu’il en soit, les dispositifs et les méthodes d’investigation pour y faire une place de choix à l’image. Toutefois, en rejoignant le point de départ de cette boucle introspective sur les déboires de la photographie dans le projet Suburbu et le « rattrapage » opéré par l’introduction de deux récits photographiques sur le travail en ville, construits en dehors du projet mais s’y appliquant parfaitement, je suggère que le mieux pour remédier à nos carences en matière de photographie aurait été de travailler de manière plus étroite avec des photographes aguerris. Les images de Keith Ntwari et Pacifique Bukuru se sont bien ajustées aux idées du programme qui s’intéressait à la routine et aux gestes du labeur urbain. Ils ont su l’un et l’autre capter des instants significatifs de la journée d’un vendeur de boulettes de viande ambulant (clichés 7 et 8) et d’une « yaya » exploitée et épuisée de travail (clichés 9 et 10). Ce sont de « bonnes photos » d’enquête car elles résolvent le dilemme de l’esthétisme et du contenu scientifique en conciliant la qualité technique de clichés artistiques et des éléments informatifs capables de nourrir des démonstrations en sciences sociales (Bajard 2017). Je ne doute pas qu’une proximité plus longue ou des échanges plus réguliers avec eux, ou d’autres photographes, auraient augmenté les chances que l’équipe dispose à la fin du projet de « bonnes » et « intéressantes » photos.
Conclusion
Contrairement à l’impression qu’il donne peut-être par son titre et ses développements, cet article n’est ni un texte à charge contre notre équipe et le projet Suburbu qu’elle a mené pendant trois ans, ni un acte de contrition gratuit. Notre échec est relatif si l’on en juge par les textes et les manifestations que nous avons produits d’un côté, et ce qu’il m’a été possible de dire de nos photographies de l’autre, et ce sont surtout des constats de faiblesse et de méconnaissance et des possibilités de solutions qui sous-tendent mon propos, plus que des condamnations de nos préjugés et réticences.
J’ai évoqué dans les lignes précédentes des questions théoriques, d’accès au terrain, d’habitudes disciplinaires, de préjugés culturels, de normes et de répartition croisée des compétences professionnelles, qui méritaient d’être explicitées pour cerner les circonstances des défaillances qui ont marqué notre pratique photographique. Ce qu’il me semble en définitive important de noter pour conclure, c’est qu’il existe deux indications nécessaires et suffisantes pour adopter la photographie comme un véritable outil méthodologique et la considérer comme productrice de connaissances et potentiellement vectrice de cette connaissance auprès du public. Les garder à l’esprit dès les débuts de l’énonciation d’un projet est un conseil qui peut éviter les déconvenues. D’abord, il faut être convaincu et persuader chacun∙e du bien-fondé d’une démarche qui fait de la prise de vue une technique d’enquête et de l’image un support de raisonnement analytique et de diffusion scientifique. Cela suppose des lectures et des exemples qui peuvent asseoir l’idée que, différemment des supports écrits ou oraux mais en complément à ceux-ci, la photographie est légitime pour donner intelligibilité et sens à la recherche. Ensuite, cela implique que des notions soient apprises et des compétences acquises dans le versant technique et pratique du geste photographique. Même si l’air du temps est propice à la circulation débridée des selfies, on ne s’improvise pas photographe. L’apprentissage de l’image, ou mieux, l’accompagnement d’un professionnel de l’image, me paraissent donc être les alternatives les plus sûres pour ne pas manquer le tournant visuel qu’ont déjà abordé la plupart des disciplines du champ social. C’est au prix de ces deux conditionnalités que l’usage de la photographie dans les enquêtes peut augmenter leur potentiel analytique, et lever la suspicion d’esthétisation des phénomènes sociaux qui pèse encore sur elle dans certains mondes académiques frileux. La valorisation des clichés par leur exposition publique vient ensuite, elle n’est que l’une des modalités de leur utilisation parmi d’autres.